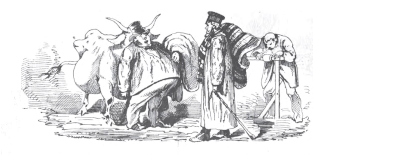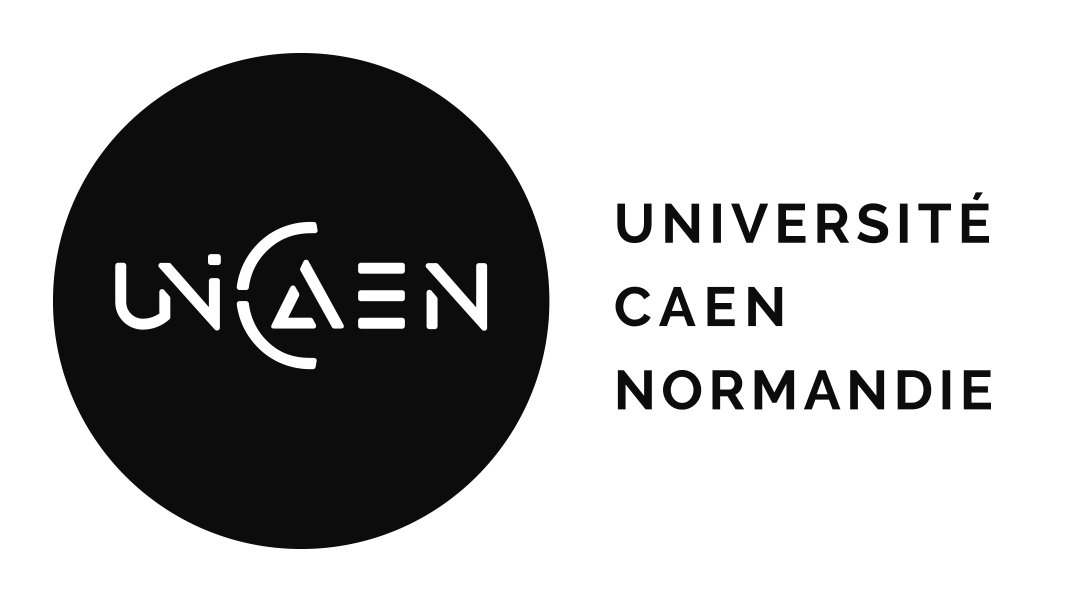Claude Mérigot, de Dozulé, à Paris
Anonyme
Claude Mérigot, de Dozulé, à Paris
Éléments contextuels
1838
xixe siècle
Non localisé
Pays d’Auge
Édition du texte
| Le Normand | Gazette des Tribunaux |
| Claude Mérigot, de Dozulé, à Paris Antoine. – On n’a jamais vu comme ça empoigner un homme !… On a donc ressuscité les gendarmes ?… Mais qu’est-ce que j’ai fait ? Voyons, qu’on me dise, pour que je triomphe victorieusement. M. le président. – Vous savez très-bien que vous êtes ici pour avoir donné un coup de bouteille sur la tête de Claude Mérigot. Antoine. – Et il viendra encore se dire mon cousin, après m’avoir fait arriver de la peine, et m’induire sur le banc des criminels pour un rien du tout comme ça !… Quand je disais que j’avais raison de ne pas en vouloir, de parens. M. le président. – Laissez parler le plaignant. Antoine. – Qu’il parle ! Qu’il parle ! C’est pas moi qui veut l’y en empêcher… Ça m’fera plaisir de l’entendre ce cher cousin. Claude Mérigot. – Le cousin m’a allongé une torgnole, donc !… La v’là, la torgnole !… Elle a quasi ben un pouce au-dessus de l’oreille. M. le président. – Dites comment est venue la querelle, par suite de laquelle il vous a ainsi frappé. Claude Mérigot. – La querelle !… Ah ! oui, les mots !… J’vas vos dire, c’est qu’y en a vraiment pas eu. Il a tapé tout d’suite, l’cousin. M. le président. – Enfin, dites comment les faits se sont passés. Claude. – J’vas vos dire… J’suis de Dozulé, près de Lisieux, en Normandie, qu’est mon pays, oùs ce que j’suis né, et ma famille avec quoi que j’demeure… Pour lors, ma mère voulait m’faire travailler aux champs, planter des betteraves, des choux et gauler des pommes… Mais moi, je n’ai point d’goût zà la chose… j’mordais pas aux pommes… Pour lors la bonne femme m’dit : « Quoique tu veux donc faire gas, men fils ? – Maçon que je lui dis, comme ça. Maçon… – Tiens ! justement, y a ton cousin Antoine qu’est dans la chose à Paris… Va l’trouver, il t’lancera… Elle avait confiance, la bonne femme, tout comme moi aussi… Pour lors, j’viens à Paris oùs ce que je suis enfin, et j’m’en vas tout droit au garni du cousin Antoine… Il fait grève, qu’on m’dit ; vous le trouverez au cabaret du coin du quai Pelletier. J’comprenais pas, mais j’y vas tout d’même. Je m’fais indiquer, j’demande Antoine ; on m’dit comme ça de monter, j’monte ; je d’mande encore Antoine… « Qu’est-ce qui d’mande Antoine ? que me crie comme ça une grosse voix. – C’est moi que j’d’mande Antoine. – Le v’là Antoine !… – « Oh ! Cousin ! » que je m’écrie, et je m’lace dans ses bras. D’abord il ne me reconnaissait point ; ce n’est pas étonnant, vu qui n’m’avait jamais vu… J’suis vot’cousin, que j’lui dit… – « Tiais ! C’est toi vieuille bète. » – Eh ! oui, c’est moi, Claude Mérigot, cousin issu de germain, du côté des femmes, par vot’tante Boulet, qu’est la cousine de la mienne, la sœur de ma mère, Marie Rabot, femme Mérigot. Il n’avait pas l’air de m’comprendre… « C’est égal, qui m’dit, dit-il comme comme ça, assis-toi là ! » Il m’verse à boire, nous buvons avec d’autres qu’étaient là, et j’causimes… L’cousin était un peu dans les vignes, ven d’ssus, ven d’ans… V’là qui s’met comme ça à m’gouailler avec les camarades… à m’dire que j’ai tort de vouloir être maçon… que j’ai pas une figure à ça… qu’avec mon physique de poréchinelle j’ferai mieux d’entrer dans l’régiment, sauf vot’respect, des Berlot-Berlots de Dozulé… Enfin quoi, un tas d’humiliances… Moi je m’vesque, et j’lui dis qu’on ne traite pas ainsi un cousin, issu de germain, et qu’il est un pas grand’chose lui. « T’es m’en cousin, qui me répond : Eh ben ! Tiens, porte ça à ma tante !… » Et il m’soigne d’un coup de bouteille, quoi ! sus la boussole… Si on ne m’avait pas séparé de ses mains, il m’pilait comme du mortier, ben sûr. Deux maçons qui buvaient avec Antoine sont appelés comme témoins. Amis et compagnons du prévenu, ils cherchent à atténuer ses torts. « Ce Normand-là a un mauvais caractère, dit l’un d’eux. Il n’entend pas la plaisanterie, et il faut ça dans le bâtiment… Quand un nophyte insulte les anciens pour des mots, on le cogne… V’là l’usage dans le bâtiment. » M. le président. – C’est un usage auquel, dans votre intérêt, je vous engage à renoncer… (À Antoine:) Convenez-vous avoir porté un coup de bouteille au plaignant ? Antoine. – Ça se peut bien… Il m’disait qu’il était mon cousin, et entre parens on devrait se pardonner ça. M. le président. – Justement, parce qu’il est votre parent, vous n’en êtes que plus coupable. Antoine. – Pourquoi qu’il se fâche quand j’plaisente avec lui ? D’ailleurs, qu’est-ce qui m’dit qu’il est mon cousin ? C’est p’tèt pas vrai ; j’m’en fiche pas mal, de mes cousins ; j’en ai bien cinquante. Est-ce que je les connais ? J’aime pas les parens, moi ; à la bonne heure, les amis ! Le tribunal condamne Antoine à quinze jours de prison, à 30 fr. d’amende, et à 50 fr. de dommages-intérêts envers Claude Mérigot, qui s’était porté partie civile, et qui en Normand bien appris, ne réclamait pas moins de 1,500 fr. | Paris, 26 mai Antoine. – On n’a jamais vu comme ça empoigner un homme !… On a donc ressuscité les gendarmes ?… Mais qu’est-ce que j’ai fait ? voyons, qu’on me le dise, pour que je triomphe victorieusement. M. le président. – Vous savez très bien que vous êtes ici pour avoir donné un coup de bouteille sur la tête de Claude Mérigot. Antoine. – Et il viendra encore se dire mon cousin, après m’avoir fait arriver de la peine et induire sur le banc des criminels pour un rien du tout comme ça !… Quand je disais que j’avais raison de ne pas en vouloir, de parens. M. le président. – Laissez parler le plaignant. Antoine. – Qu’il parle ! qu’il parle ! c’est pas moi qui veux l’y en empêcher… ça me fera plaisir de l’entendre, ce cher cousin. Claude Mérigot. – Le cousin m’a allongé une torgnole, donc !… La v’là, la torgnole !… elle a quasi ben un pouce au-dessus de l’oreille. M. le président. – Dites comment est venu la querelle par suite de laquelle il vous a ainsi frappé. Claude. – La querelle !… ah ! oui, les mots !… j’vas vous dire, c’est qu’y en a vraiment pas eu… Il a tapé tout de suite, l’cousin. M. le président. – Enfin, dites-nous comment les faits se sont passés. Claude. – J’vas vous dire… j’suis de Dozulé, près de Lisieux, en Normandie, qu’est mon pays, ous que j’suis né, et ma famille, avec quoique j’demeure… Pour lors, ma mère voulait m’faire travailler aux champs, planter des betteraves et gauler des pommes… Mais moi j’ai pas d’goût à la chose… j’mordais pas aux pommes… Pour lors, ma mère me dit : « Quoi que tu veux donc faire, gas ? –Maçon, que je lui dis. Maçon !… Tiens ! justement, y a ton cousin Antoine qu’est dans la chose à Paris… Va le trouver, il te lancera… Elle avait confiance, la bonne femme, et moi aussi… Pour lors, je viens à Paris, et j’men vas tout droit au garni du cousin Antoine… Il fait Grève, qu’on m’dit ; vous le trouverez au cabaret du coin du quai Pelletier… J’comprenais pas, mais j’y vas tout d’même… Je m’fais indiquer, j’demande Antoine, on m’dit d’monter, j’monte ; je d’mande encore Antoine… « Qu’est-ce qui d’mande Antoine ? que me crie une grosse voix. – C’est moi que j’demande Antoine. – Le v’là Antoine !… – « Oh ! cousin ! » que je m’écrie, et je me lasse dans ses bras. D’abord, il ne me r’connaissait pas, ce qu’est pas étonnant, vu qu’il ne m’avait jamais vu… J’suis vot’ cousin, que je lui dis… Claude Mérigot, cousin issu de germain, du côté des femmes, par vot’ tante Boulet, qu’est la cousine de la mienne, la sœur de ma mère, Marie Rabot, femme Mérigot… Il n’avait pas l’air de comprendre… « C’est égal, qu’il m’dit, assis-toi là !… » Il m’verse à boire, nous buvons avec d’autres qu’étaient là, et nous causâmes… L’cousin était un peu dans les vignes… v’là qu’il se met à me gouailler avec les camarades… à m’dire que j’ai tort de vouloir être maçon… que j’ai pas une figure à ça… qu’avec mon physique de polichinelle, je ferais mieux d’entrer dans l’régiment des casses-noisettes… enfin un tas d’humiliances… Moi, je me vexe, et je lui dis qu’on n’traite pas ainsi un cousin, et qu’il est un pas grand’chose. « T’es mon cousin, qu’il m’répond ; eh ben ! tiens, porte ça à ma tante !… » Et il me soigne un coup de bouteille… Si on ne m’avais pas séparé de ses mains, il me pilait comme dans du mortier, bien sûr. Deux maçons qui buvaient avec Antoine sont appelés comme témoins. Amis et compagnons du prévenu, ils cherchent à atténuer ses torts. « C’Normand-là a un mauvais caractère, dit l’un d’eux. Il n’entend pas la plaisanterie, et il faut ça dans le bâtiment… Quand un nophyte insulte les anciens pour des mots, on l’cogne… v’là l’usage dans le bâtiment. » M. le président. – C’est un usage auquel, dans votre intérêt, je vous engage à renoncer… (À Antoine) Convenez-vous avoir porté un coup de bouteille au plaignant ? Antoine. – Ça se peut bien… Il m’ disait qu’il était mon cousin, et, entre parens, on devrait se pardonner ça. M. le président. – Justement parce qu’il est votre parent, vous n’en êtes que plus coupable. Antoine. – Pourquoi qu’il se fâche quand j’plaisante avec lui ? D’ailleurs qu’est qui m’dit qu’il est mon cousin ? C’est p’tèt’ pas vrai ; j’m’en fiche pas mal, de mes cousins ; j’en ai bien cinquante. Est-ce que je les connais ? J’aime pas les parens, moi ; à la bonne heure, les amis ! Le tribunal condamne Antoine à quinze jours de prison, à 30 fr. d’amende, et à 50 fr. de dommages-intérêts envers Claude Mérigot, qui s’était porté parti civile, et qui, en Normand bien appris, ne réclamait pas moins de 1,500 fr. |
Commentaire sur l’édition
Édition faite sur les originaux.
Source ou éditions princeps
Le Normand, 8 juin 1838.
La Gazette des Tribunaux, 27 mai 1838.
Édition critique
Patrice Lajoye, « Quelques saynètes humoristiques du Pays d’Auge du xixe siècle », Bulletin de la Société historique de Lisieux, 94, 2022, p. 134-139.
Études
Patrice Lajoye, « Quelques saynètes humoristiques du Pays d’Auge du xixe siècle », Bulletin de la Société historique de Lisieux, 94, 2022, p. 133-151.
Commentaire historique et contextuel
Publié dans la Gazette des Tribunaux du 27 mai 1838, ce texte est repris initialement dans le journal Le Temps du 2 juin 1838, puis il sera inclus en 1859 dans un recueil de saynètes judiciaires signés sÉmile Colombey (pseudonyme du romancier Emile Laurent : Les Causes gaies, [1859], Paris, Hachette, p. 135-137. À Lisieux, c'est le journal Le Normand qui le republie, dans son édition du 8 juin 1838. L'intérêt de cette réédition réside dans le fait que le texte est alors remanié : plusieurs phrases sont ajoutées, et le caractère dialectal des paroles du plaignant, Claude Mérigot de Dozulé est encore accentué. Il est possible de douter de l'historicité de cette saynète. En effet, nous n’avons pu retrouver aucun Claude Mérigot dans le recensement de Dozulé de 1836. Il n'est toutefois pas impossible qu'il se soit dit « de Dozulé », tout en étant originaire d'une des communes limitrophes.
Commentaire linguistique
–