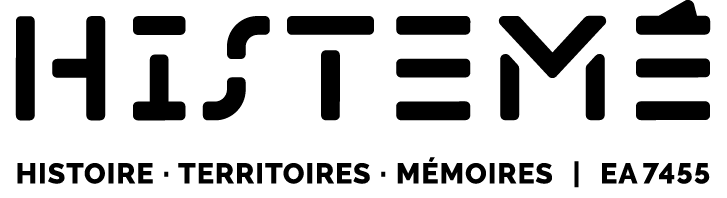Répression et persécutions allemandes en Normandie, 1940-1945
Par Gaël Eismann et Françoise Passera
Pour citer cet article
Gaël Eismann et François Passera, « Répression et persécutions allemandes en Normandie, 1940-1945 », in Dictionnaire des victimes du nazisme. Normandie 1940-1945 [en ligne], https://mrsh.unicaen.fr/dictionnaire-victimes-nazisme-normandie/resultats.html.
Pour éclairer les milliers de parcours individuels restitués dans le Dictionnaire des victimes du nazisme en Normandie, ce texte [1] 1. Seules les cita (…) se propose de les replacer dans le cadre plus large des politiques de contrôle, de répression et de persécution allemandes mises en œuvre en France occupée [2] 2. Rattachés au Co (…) entre 1940 et 1945 [3] 3. Le récit inédit (…) . Tout au long de l’Occupation, les civils arrêtés par les forces de l’ordre – qu’elles soient militaires ou non, françaises ou allemandes – sont orientés dans le système de répression et de persécution selon la lecture qui est faite de leur dossier, les instruments mobilisables à un instant T et les impératifs du moment. Les exigences d’un programme spécifique (de réquisition de main d’œuvre par exemple), l’évolution des urgences répressives face à la montée des oppositions, le calendrier de la « Solution finale de la question juive », les enjeux de la Collaboration, etc. modèlent des normes et des dispositifs répressifs dont le décryptage est indispensable pour comprendre la complexité et les éventuelles spécificités des trajectoires de répression comme de persécution des quelque 5400 victimes du nazisme en Normandie recensées dans ce dictionnaire.
Quatre temps peuvent être ainsi mis en évidence. Le premier est celui de l’invasion. L’arrivée des troupes allemandes en Normandie a en effet donné lieu à un certain nombre d’exactions perpétrées par les troupes d’opération. Le second temps, qui court de juillet 1941 à juin 1943, est celui de la radicalisation et du basculement vers une logique idéologico-sécuritaire. À partir de l’été 1943, la répression allemande qui visait depuis l’été 1941 principalement les ennemis idéologiques du Reich, communistes et Juifs en particulier, ainsi que tous ceux qui s’en prenaient directement à ses intérêts, change de nature et touche des fractions de plus en plus larges de la population. Avec le Débarquement de Normandie enfin, les actions de la Résistance ne sont plus considérées comme un simple problème policier. Elles sont aussi et surtout devenues un problème militaire, transformant potentiellement tout civil en agent de l’ennemi.
1. De l’invasion allemande en France… à celle de l’URSS, juin 1940-juin 1941
↑Le 7 juin 1940, les troupes de la Wehrmacht, appuyées par les bombardements de la Luftwaffe, pénètrent en Normandie dans la région de Forges-les-Eaux et Gournay. Le 8 juin, elles atteignent la Seine à Pont-de-l’Arche et Château Gaillard pendant que les blindés de Rommel s’arrêtent devant Rouen. La ville est prise le lendemain, le 9 juin. Piégé dans la nasse de Saint-Valery-en-Caux, le corps expéditionnaire britannique se replie par la mer, laissant derrière lui nombre de soldats. Désormais, l’objectif se situe dans le Cotentin : prendre le port militaire de Cherbourg avant la signature de l’armistice. Malgré l’opiniâtreté d’une poignée de soldats français, la défense est rompue. Cherbourg, encerclée, se rend le 20 juin.

Coupée de sa hiérarchie – le ministère de l’Intérieur s’est replié à Paris, puis à Tours et enfin à Bordeaux – l’administration locale – préfets et municipalités – ne peut s’appuyer sur aucune instruction pour régir ses relations avec l’Occupant. Côté allemand, le maintien de l’ordre relève essentiellement des troupes opérationnelles jusqu’à la signature de l’armistice le 22 juin 1940, celles de l’armée de terre (Heer) qui investissent les villes, de la Luftwaffe qui prennent les aérodromes et de la Kriegsmarine qui s’installent dans les ports.
1.1. Les exécutions sommaires lors de l’invasion
↑Lorsque les combats sont encore vifs, en Seine-Inférieure et dans l’Eure notamment, les troupes allemandes peuvent se révéler d’une grande violence envers les civils. Les soldats, imprégnés de la peur des francs-tireurs de la Guerre de 1870, voient dans les civils une menace. Suspectés de pillage, d’espionnage ou d’être des soldats déguisés, les habitants sont à la merci d’un soldat nerveux, à la gâchette facile. Si les exactions ne revêtent pas l’ampleur de celles perpétrées dans le Nord, l’Oise ou la Somme, il n’en reste pas moins qu’une trentaine d’exécutions sommaires ont été à ce jour identifiées en Normandie.
Le plus souvent – lorsque la scène se déroule devant témoin – les victimes sont des
individus qui ont cherché à se défendre avec des armes désuètes, ou qui sont suspectés
de pillage ou de sabotage. Dans le Calvados, à Orbec, l’ouvrier agricole Fernand Bourguignon  est abattu pour avoir brandi son rasoir devant un soldat allemand. À Sassetot-le-Mauconduit
(Seine-Maritime) quatre civils arrêtent, désarment et emprisonnent un éclaireur motocycliste
allemand qui avait pénétré dans le village le 10 juin. Conscient des risques encourus,
le maire le libère rapidement de sa prison improvisée… Mais le soldat prévient sa
hiérarchie, laquelle procède, sans autre forme de procès, à l’exécution sur la place
publique de quatre hommes : Ernest Avenel
est abattu pour avoir brandi son rasoir devant un soldat allemand. À Sassetot-le-Mauconduit
(Seine-Maritime) quatre civils arrêtent, désarment et emprisonnent un éclaireur motocycliste
allemand qui avait pénétré dans le village le 10 juin. Conscient des risques encourus,
le maire le libère rapidement de sa prison improvisée… Mais le soldat prévient sa
hiérarchie, laquelle procède, sans autre forme de procès, à l’exécution sur la place
publique de quatre hommes : Ernest Avenel  , Georges Blondel
, Georges Blondel  , Charles Déporté
, Charles Déporté  et Jean Hervieux.
et Jean Hervieux. 
En Normandie comme ailleurs, les préjugés racistes des troupes allemandes, à l’encontre
des tirailleurs sénégalais notamment, ont aussi pu être directement à l’origine des
pires exactions. C’est ce qui se produit à Rouen le 9 juin 1940. Ce jour-là, des soldats
allemands ratissent la ville et arrêtent dix soldats coloniaux ainsi que neuf civils
dont la peau s’avère beaucoup trop sombre pour les vainqueurs. Amoro Allanmé  (Éthiopien, aide-cuisinier), Narcisse Fabri
(Éthiopien, aide-cuisinier), Narcisse Fabri  (Guadeloupéen, marin ou docker), Fara Gomis
(Guadeloupéen, marin ou docker), Fara Gomis  (Sénégalais, marin) font partie de ceux-là. Alors qu’ils ne présentaient manifestement
aucun danger pour la sécurité militaire allemande, tous sont exécutés dans des propriétés
discrètes, à l’écart des rues passantes [4] 4. G. Lemaitre, L. (…) . Rares sont les coupables de ces crimes de guerre à avoir été identifiés.
(Sénégalais, marin) font partie de ceux-là. Alors qu’ils ne présentaient manifestement
aucun danger pour la sécurité militaire allemande, tous sont exécutés dans des propriétés
discrètes, à l’écart des rues passantes [4] 4. G. Lemaitre, L. (…) . Rares sont les coupables de ces crimes de guerre à avoir été identifiés.
L’arrêt des combats et la signature de l’armistice le 22 juin 1940 ne signifient pas la fin de la guerre en Normandie. Tous les regards allemands se tournent désormais de l’autre côté de la Manche. L’opération Seelöwe vise à prendre pied en Angleterre grâce à une invasion menée à partir des côtes normandes. En conséquence, la Normandie reste une zone militaire stratégique soumise à une surveillance intense… On estime alors que 375 000 hommes se déploient dans la région, notamment sur les côtes et dans l’Eure, où les aérodromes sont nombreux.
1.2. Un dispositif répressif principalement judiciaire
↑Si jusqu’à la fin de l’année 1940 les troupes opérationnelles mènent encore occasionnellement des opérations de maintien de l’ordre, les autorités militaires d’occupation se substituent de plus en plus souvent à elles dès le début de l’été. Le MBF, Militärbefehlshaber in Frankreich (commandement militaire allemand en France) auquel revient l’exercice des droits de la puissance occupante en zone Nord s’installe à l’hôtel Majestic [5] 5. G. Eismann, Hôt (…) à Paris et déploie son administration militaire sur l’ensemble du territoire.
Calquées sur les circonscriptions administratives des préfectures, les Feldkommandanturen de Saint-Lô, Alençon, Caen, Évreux et Rouen supervisent désormais le maintien de l’ordre en Normandie.
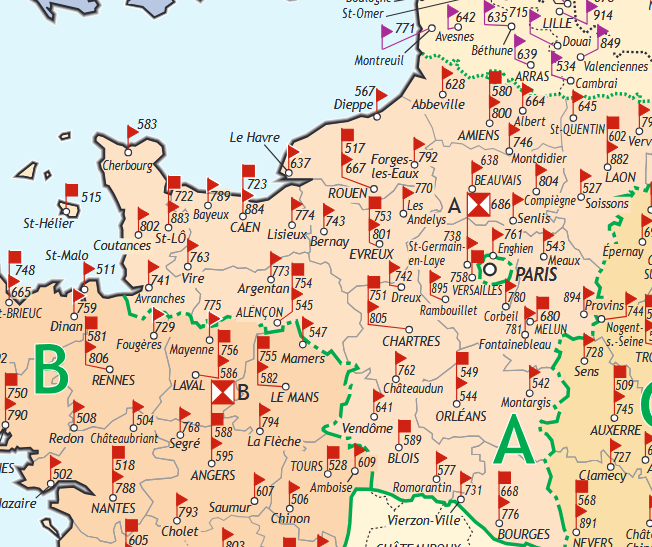
Jusqu’à l’été 1941, la politique de « maintien de l’ordre et de la sécurité » du MBF repose avant tout sur une administration dite de « surveillance ». Elle laisse, en théorie, aux autorités françaises le soin de préserver de façon autonome la sécurité et l’ordre publics, aussi longtemps que les impératifs liés à la sécurité de la puissance occupante n’en souffrent pas. L’autonomie concédée aux autorités françaises est toutefois très relative. Elle n’est accordée que dans un cadre sécurisé qui donne à l’occupant un « droit de regard » très étendu. Car le droit de « surveillance » que s’arroge l’administration militaire allemande, au nom de l’exercice des « droits de la puissance occupante », n’est rien moins qu’un pouvoir d’ingérence conduisant à un assujettissement partiel de l’appareil répressif français. La sécurité et l’ordre publics en France occupée sont par conséquent essentiellement assurés par l’administration française, mais sous la tutelle étroite du MBF et de ses antennes régionales et départementales.
En cas d’atteinte directe à la sécurité ou aux intérêts de la puissance occupante, les Allemands reprennent la main et exercent une répression d’emblée implacable.
L’administration militaire peut pour ce faire compter sur sa Feldgendarmerie, chargée d’assurer au quotidien les tâches de police en cas de délits mineurs : vols, marché noir, accidents de voiture, application du couvre-feu, etc. Elle déploie ses troupes dans les cinq départements normands, de façon plus ou moins dense, en fonction du nombre d’habitants et des enjeux locaux de surveillance. Ainsi, dans l’Eure, des troupes stationnent à Bernay, Louviers, aux Andelys et à Évreux. Les tâches de police judiciaire relèvent quant à elles prioritairement de la Geheime Feldpolizei (GFP). Sa cible essentielle est la Résistance et tout ce qui peut lui être attribué : sabotages, attentats, propagande ennemie, etc. Deux groupes GFP composés de 65 à 100 personnes s’installent à Caen (Gr. 312) et à Rouen (Gr.701), avec des commissariats à Saint-Lô, le Havre, Évreux et Alençon. S’y ajoute une antenne dans le port de Cherbourg. Enfin, l’Abwehr (service de contre-espionnage de la Wehrmacht), dispose aussi de quelques hommes dans la région.
Les dispositions prises par le MBF durant la première année d’occupation, alors unanimement qualifiée de paisible, jettent très tôt les bases d’une politique répressive inflexible. Mais si les services du MBF pratiquent, dès la fin de l’année 1940, l’internement administratif et infligent régulièrement des sanctions collectives aux populations civiles (extension du couvre-feu et amendes en particulier), incluant la prise d’otages en représailles d’actions directes dirigées contre la puissance occupante (sectionnements de câbles de transmission en particulier), ils n’appliquent pas encore les représailles les plus lourdes prévues par les ordonnances du MBF, c’est-à-dire les exécutions d’otages. Surtout, jusqu’à l’été 1941, ces pratiques correspondent encore à l’usage militaire traditionnel des armées en campagne. Les otages sont majoritairement désignés parmi les notables des localités où se sont produits des actes hostiles à la puissance occupante.
L’essentiel du dispositif répressif repose alors sur ses tribunaux militaires, auxquels incombe de poursuivre tous les civils, hommes et femmes confondus, coupables d’atteintes à la sécurité et plus largement aux intérêts de la puissance occupante. De fait, les sanctions pénales constituent l’essentiel de la répression allemande jusqu’à la fin juin 1941. La multiplication des manifestations antiallemandes et autres de signes de « non-consentement » au nouvel Ordre allemand entraînent de nombreuses arrestations de civils jugés pour « sabotage », « aide à l’ennemi », « voie de fait à l’encontre de l’armée allemande », mais aussi pour « vol qualifié », « distributions de tracts », simple « manifestation antiallemande » ou encore « injure à l’armée allemande ». Plus 150 Normands passent devant les tribunaux cette première année d’occupation, la plupart pour ce type de motifs.
Souvent considéré comme le premier condamné à mort, Étienne Achavanne  est fusillé à Blosseville-Bonsecours près de Rouen, le 4 juillet, après avoir été
jugé par un tribunal de la Luftwaffe pour avoir sectionné des câbles électriques menant
à l’aérodrome de Boos-Rouen. Jules Becquemont
est fusillé à Blosseville-Bonsecours près de Rouen, le 4 juillet, après avoir été
jugé par un tribunal de la Luftwaffe pour avoir sectionné des câbles électriques menant
à l’aérodrome de Boos-Rouen. Jules Becquemont  et Céleste Thouan
et Céleste Thouan  subissent la même peine pour le même délit début 1941. Le cas de deux jeunes hommes,
Roger Coupé
subissent la même peine pour le même délit début 1941. Le cas de deux jeunes hommes,
Roger Coupé  et Michel Coupry
et Michel Coupry  , illustre bien les modalités de la répression en ces débuts d’occupation. Les deux
jeunes garçons sont suspectés d’avoir construit un barrage sur une route de l’Orne
afin de gêner le trafic des véhicules allemands. La gendarmerie locale ne parvenant
pas à les localiser, les autorités militaires et la Geheime Feldpolizei (GFP) prennent les choses en main… Et quelques otages
dans les municipalités aux alentours de Rugles et Saint-Sulpice afin de hâter les
arrestations. Finalement dénoncés, les fugitifs sont interpellés par la gendarmerie
et livrés aux autorités d’occupation. Jugés par le tribunal militaire de Laigle, ils
écopent dans un premier temps de peines de simple prison. Un second jugement en appel
autrement plus sévère est prononcé par le tribunal de la Feldkommandantur d’Alençon pour « acte de franc-tireur » quelques semaines plus tard. Le plus âgé
des deux, Michel Coupry, bien qu’encore mineur, est condamné à mort. Roger Coupé écope,
quant à lui, de huit ans de réclusion.
, illustre bien les modalités de la répression en ces débuts d’occupation. Les deux
jeunes garçons sont suspectés d’avoir construit un barrage sur une route de l’Orne
afin de gêner le trafic des véhicules allemands. La gendarmerie locale ne parvenant
pas à les localiser, les autorités militaires et la Geheime Feldpolizei (GFP) prennent les choses en main… Et quelques otages
dans les municipalités aux alentours de Rugles et Saint-Sulpice afin de hâter les
arrestations. Finalement dénoncés, les fugitifs sont interpellés par la gendarmerie
et livrés aux autorités d’occupation. Jugés par le tribunal militaire de Laigle, ils
écopent dans un premier temps de peines de simple prison. Un second jugement en appel
autrement plus sévère est prononcé par le tribunal de la Feldkommandantur d’Alençon pour « acte de franc-tireur » quelques semaines plus tard. Le plus âgé
des deux, Michel Coupry, bien qu’encore mineur, est condamné à mort. Roger Coupé écope,
quant à lui, de huit ans de réclusion.
Certes, les jugements rendus en cas d’opposition manifeste au nouvel Ordre allemand sont encore marqués par une certaine retenue la première année d’Occupation. Retenue toute relative cependant : les tribunaux du MBF prononcent quand même près de 150 condamnations à mort dont 38 sont exécutées avant le 22 juin 1941, alors que tous les observateurs allemands qualifient encore la situation de paisible en France occupée. Des pratiques qui tranchent avec l’image d’une armée allemande que la propagande nazie cherche à présenter comme une structure de recours en opposant « la correction » du soldat allemand à la traitrise du soldat britannique.
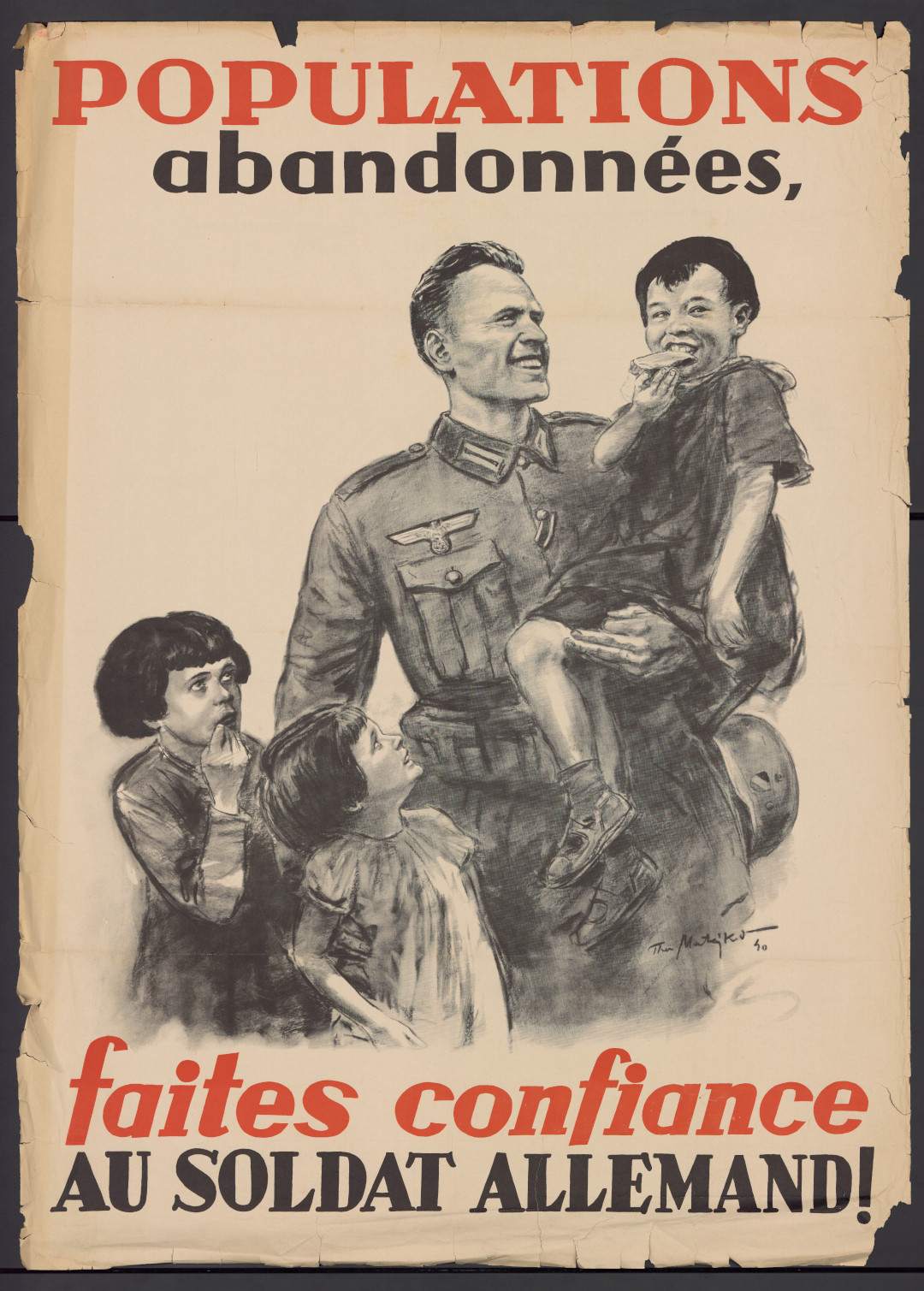
En Normandie, dix peines capitales sont exécutées avant le mois de juillet 1941. Trois
Eurois en font les frais. Pour avoir tué un soldat allemand lors de l’invasion, le
10 juin 1940, Benoni Pantin  , son fils Aimé
, son fils Aimé  et Cyrille Guerlédan
et Cyrille Guerlédan  sont fusillés sur la place publique à Notre-Dame-de-l’Isle le 21 avril 1941 Les affaires
de câbles coupés figurent parmi les chefs d’accusation les plus fréquents. Elles conduisent
en 1941 Joseph Madec
sont fusillés sur la place publique à Notre-Dame-de-l’Isle le 21 avril 1941 Les affaires
de câbles coupés figurent parmi les chefs d’accusation les plus fréquents. Elles conduisent
en 1941 Joseph Madec  du Havre et Léon Jourdan
du Havre et Léon Jourdan  de Flottemanville-Hague (Manche) au peloton d’exécution.
de Flottemanville-Hague (Manche) au peloton d’exécution.
Dans le ressort du MBF, 60 à 70 % des condamnés à mort n’en sont pas moins encore graciés la première année d’occupation. Ce fut notamment le cas en Normandie de Max Allain, André Picart et Marcel Le Foll qui s’en étaient pris à des marins allemands dans le port du Havre. Condamnés à mort par le tribunal de la FK de Rouen, leurs peines sont commuées en dix ans de travaux forcés en février 1941. Peines qu’ils purgeront à la prison de Saarbrücken à partir du mois de mai 1941.
En Normandie comme ailleurs, les infractions renvoyant à des comportements relevant au sens large du « non consentement », qu’il s’agisse de gestes de refus exprimant une hostilité envers la puissance occupante mais considérés comme mineurs, en pratique essentiellement des délits d’opinion, ou de comportements de refus certes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la puissance occupante, mais n’impliquant pas nécessairement l’intention de lui nuire (détention d’armes, franchissement des lignes interdites, trafic de courrier, non-respect du couvre-feu, falsification de papiers, etc.) donnent en revanche presque exclusivement lieu à des peines privatives de liberté.
La plupart des peines privatives de liberté sont, à ce stade de l’Occupation, exécutées
en France occupée. En Normandie, des « quartiers allemands » sont ouverts dans les
prisons des grandes villes, comme à la maison d’arrêt de Caen, au palais de justice
ou à la prison Bonne Nouvelle de Rouen, ou encore au château des Ducs à Alençon. Un
certain nombre de condamnés sont toutefois précocement déportés vers les prisons du
Reich pour y purger leurs peines. Ce fut le cas d’une trentaine de Normands transférés
à Düsseldorf, Saarbrücken ou Karlsruhe. Ainsi de François de Hautecloque  [6] 6. F. de Hautecloc (…) et de son épouse, jugés par un tribunal de guerre de la Wehrmacht le 4 août 1940 puis envoyés purger leur peine à la prison de Wittlich. Après extinction
de leur peine, ils reviennent en France et sont placés sous surveillance.
[6] 6. F. de Hautecloc (…) et de son épouse, jugés par un tribunal de guerre de la Wehrmacht le 4 août 1940 puis envoyés purger leur peine à la prison de Wittlich. Après extinction
de leur peine, ils reviennent en France et sont placés sous surveillance.
1.3. Premiers coups de butoir contre la résistance
↑En Haute-Normandie, où le corps expéditionnaire britannique avait été acculé sur les
côtes de la région de Saint-Valery-en-Caux, se cachent encore de nombreux soldats
qui ont d’abord bénéficié de l’aide spontanée des habitants de la région, sans autre
horizon que le secours immédiat à apporter à des personnes traquées. Des chaines de
contacts s’improvisent ensuite. Elles permettent aux fugitifs de survivre jusqu’à
donner naissance ou passer le relais à des réseaux constitués tel que le réseau britannique
Pat O’ Leary, susceptibles de prendre en charge l’organisation de l’évasion. L’une des affaires
les plus emblématiques en la matière est « l’affaire de Veules-les-Roses », laquelle
implique des habitants de Seine-Inférieure d’horizons très divers : médecins, hôteliers,
agriculteurs, retraités, etc. Les femmes y occupent une place importante. Ainsi de
Marcelle Bochet  , la tenancière de la pension « La Pomponnette » qui, la première, accepte de nourrir
puis d’héberger les six soldats anglais réfugiés à Veules-les-Roses, mais aussi de
Geneviève Billard
, la tenancière de la pension « La Pomponnette » qui, la première, accepte de nourrir
puis d’héberger les six soldats anglais réfugiés à Veules-les-Roses, mais aussi de
Geneviève Billard  , de Léonce Famery
, de Léonce Famery  , etc. L’affaire est d’importance aux yeux des Allemands qui dépaysent le procès vers
le tribunal du Grand Paris. Le 31 juillet 1941, Jean Bourgeois
, etc. L’affaire est d’importance aux yeux des Allemands qui dépaysent le procès vers
le tribunal du Grand Paris. Le 31 juillet 1941, Jean Bourgeois  est condamné à mort aux côtés de onze autres prévenus, parmi lesquels cinq femmes.
Les quatorze prévenus restants sont condamnés à des peines de prison ou de réclusion.
Si Jean Bourgeois est fusillé au Mont-Valérien le 5 septembre 1941, la plupart des
autres condamnés quittent finalement la gare de l’Est dans un petit convoi, le 13
octobre suivant, pour une première étape à la prison de Karlsruhe.
est condamné à mort aux côtés de onze autres prévenus, parmi lesquels cinq femmes.
Les quatorze prévenus restants sont condamnés à des peines de prison ou de réclusion.
Si Jean Bourgeois est fusillé au Mont-Valérien le 5 septembre 1941, la plupart des
autres condamnés quittent finalement la gare de l’Est dans un petit convoi, le 13
octobre suivant, pour une première étape à la prison de Karlsruhe.
Le 13 février 1941, treize jeunes résistants du réseau Hector sont arraisonnés sur
le Buhara [7] 7. I. Delabruyère- (…) , alors qu’ils cherchent à rejoindre l’Angleterre pour s’engager dans les Forces françaises
libres. Jugés par le tribunal de la FK de Saint-Lô
le 20 mars 1941, la plupart sont déportés vers les prisons du Reich pour y purger
leurs peines à temps. Mais Pierre Devouassoud  et Jean Dorange
et Jean Dorange  , considérés comme les instigateurs du projet, sont condamnés à mort et fusillés le
12 avril 1941 à l’abbaye de Montebourg (Manche).
, considérés comme les instigateurs du projet, sont condamnés à mort et fusillés le
12 avril 1941 à l’abbaye de Montebourg (Manche).
Dans les premiers jours du mois de juin 1941, la police allemande démantèle l’un des
premiers réseaux de la région du Havre, le groupe Morpain. Infiltré par l’un des leurs
lors d’une opération de sauvetage d’aviateurs britanniques, il est jugé avec sévérité.
Quatre résistants, par ailleurs francs-maçons, sont condamnés à mort : Gérard Morpain,  René Brunel
René Brunel  , Robert Roux
, Robert Roux  et Georges Piat
et Georges Piat  . Ils sont passés par les armes au Mont-Valérien en avril 1942. Les autres sont déportés
pour exécuter leur peine dans les prisons du Reich.
. Ils sont passés par les armes au Mont-Valérien en avril 1942. Les autres sont déportés
pour exécuter leur peine dans les prisons du Reich.
Parmi les premières organisations de résistance dont les membres ont été précocement jugés en Normandie figurent aussi l’Organisation secrète et le Front national. Une dizaine d’entre eux sont arrêtés. La plupart purge leur peine en France jusqu’en 1942 ou 1943, avant d’être déportés ou fusillés comme otages.
Les arrestations des derniers jours du mois de juin illustrent les prémices de la
répression idéologique des mois à venir. Le jour même du déclenchement de l’Opération
Barbarossa, le 22 juin 1941, des réfugiés russes sont interpellés. La Feldgendarmerie arrête Joseph Curfist  , ingénieur chimiste, domicilié à Caen. Le lendemain Saul Frucht
, ingénieur chimiste, domicilié à Caen. Le lendemain Saul Frucht  , juif, réfugié de Russie, directeur d’un atelier de confection à Saint-Cyr-le-Vaudreuil,
est arrêté. Wladimir Grunberg
, juif, réfugié de Russie, directeur d’un atelier de confection à Saint-Cyr-le-Vaudreuil,
est arrêté. Wladimir Grunberg  , domicilié à Saint-Sauveur-le-Vicomte, subit le même sort. C’est aussi le cas à Elbeuf
de Morko Silberstein
, domicilié à Saint-Sauveur-le-Vicomte, subit le même sort. C’est aussi le cas à Elbeuf
de Morko Silberstein  , du tailleur Itsek Drapkin
, du tailleur Itsek Drapkin  qui exerce son art à Dieppe, et de Léon Rybstein
qui exerce son art à Dieppe, et de Léon Rybstein  , originaire de Rouen. Tous restent détenus jusqu’à leur déportation en septembre
1942 (transport K31 ou K32).
, originaire de Rouen. Tous restent détenus jusqu’à leur déportation en septembre
1942 (transport K31 ou K32).
Citons enfin le cas particulier de quelques réfugiés espagnols (cinq) qui étaient
arrivés en Normandie dans des groupements de travail lors de la Drôle de guerre. Arrêtés
sur le front en juin 1940 et en principe protégées par les Conventions de Genève,
Manuel Peris Alfonso  , Liern Barbera
, Liern Barbera  ou encore Rafael Inglada Arnabat
ou encore Rafael Inglada Arnabat  , républicains ou anarchistes, apatrides depuis leur arrivée en France après la fin
de la Guerre d’Espagne, sont déportés au camp de concentration de Mauthausen, fin
1940 ou début 1941.
, républicains ou anarchistes, apatrides depuis leur arrivée en France après la fin
de la Guerre d’Espagne, sont déportés au camp de concentration de Mauthausen, fin
1940 ou début 1941.
2. Juillet 1941-Juin 1943 : la répression prend une tournure politique et idéologique
↑Le 22 juin 1941, afin d’agrandir « l’espace vital » des populations « aryennes », Hitler ordonne l’invasion de l’Union Soviétique. Le Reich affiche désormais clairement son hostilité aux communistes. Une logique idéologico-répressive où cohabitent répression judiciaire à visage légal, politique des otages et externalisation de la terreur à vocation dissuasive se met dès lors en place en France. La politique antisémite des nazis qui avait trouvé un écho auprès du gouvernement de Vichy avec la publication du décret sur le statut des Juifs en octobre 1940, franchit dans ce cadre une nouvelle étape qui mène au déclenchement de la « Solution finale » en France. Polices allemandes et françaises s’entendent pour traquer leur ennemi commun : « le judéo-bolchevique ».
2.1. La résistance se développe
↑Depuis l’invasion de l’URSS, les
communistes n’ont plus d’état d’âme et s’engagent massivement dans la Résistance [8] 8. J. Quellien, F. (…) . Sous l’égide du Front national, des groupes s’implantent dans toute la région et
plus particulièrement dans les régions industrielles de Haute-Normandie. La résistance
communiste se dote en 1942 d’une organisation militaire : les Francs-tireurs et partisans
français (FTPF). André Pican  s’impose alors à la direction régionale du Parti, puis il est promu à Paris comme
adjoint de Félix Cadras, responsable national de l’Organisation. Marcel Dufriche lui
succède, secondé par André Duroméa
s’impose alors à la direction régionale du Parti, puis il est promu à Paris comme
adjoint de Félix Cadras, responsable national de l’Organisation. Marcel Dufriche lui
succède, secondé par André Duroméa  qui devient en 1943 responsable interrégional pour l’action militaire. Les responsables
départementaux entrent en clandestinité : Roger Bastion
qui devient en 1943 responsable interrégional pour l’action militaire. Les responsables
départementaux entrent en clandestinité : Roger Bastion  dans le Calvados, succède vers la fin de l’année à André Defrance
dans le Calvados, succède vers la fin de l’année à André Defrance  dans le département de la Manche. Tous vivent au quotidien sous la menace d’une arrestation.
Celles d’André Pican et de Félix Cadras en février 1942 à Paris provoquent une véritable
hécatombe dans la région.
dans le département de la Manche. Tous vivent au quotidien sous la menace d’une arrestation.
Celles d’André Pican et de Félix Cadras en février 1942 à Paris provoquent une véritable
hécatombe dans la région.
Mais ils ne sont pas les seuls. En avril 1942, l’Organisation civile et militaire
(OCM) s’implante en Normandie sous la houlette
de Marcel Girard, natif de Caen, industriel du ciment. Au mouvement est ajouté un
réseau de renseignement Centurie, rattaché au BCRA. À la fin de l’année, l’OCM se
rapproche d’un autre mouvement, Ceux de la résistance, composé d’anciens de l’Armée
des volontaires et du réseau Hector décimé fin 1941. Celui-ci s’avère particulièrement
actif en Basse-Normandie. L’organisation figure parmi les plus importantes de la région.
D’autres mouvements s’implantent aussi, tels Libération-Nord et son réseau Cohors-Asturie
qui attirent souvent des résistants peu enclins à rejoindre les rangs de la résistance
communiste. Un mouvement gaulliste, républicain, démocrate-chrétien prend pied dans
l’Orne, Résistance, du nom de son journal. Dans l’Eure, une partie des effectifs du
Front national, peu favorables aux idées communistes, rejoignent ce mouvement, tels
André Antoine  , le jeune chef régional de l’action militaire.
, le jeune chef régional de l’action militaire.
Le mouvement Vengeance et son réseau Turma sont mis sur pied à l’initiative d’un jeune
pharmacien, Bernard Lauvray,  fils du sénateur de l’Eure. Après l’arrestation de celui-ci, Louis Maury
fils du sénateur de l’Eure. Après l’arrestation de celui-ci, Louis Maury  prend la responsabilité du département où le mouvement est sans doute le mieux implanté,
même si des antennes existent dans l’Orne et un sous-réseau dans le Calvados : Arc-en-Ciel.
prend la responsabilité du département où le mouvement est sans doute le mieux implanté,
même si des antennes existent dans l’Orne et un sous-réseau dans le Calvados : Arc-en-Ciel.
De moindre importance, l’Organisation de résistance de l’armée (ORA) s’implante plus tardivement dans la région, au début de
l’année 1943. Elle participe notamment aux recrutements et aux instructions militaires
des jeunes réfractaires des mouvements de l’OCM
ou de Vengeance. Dans l’Orne, Régis des Plas  en assure la coordination.
en assure la coordination.
Auprès des mouvements, s’implantent de nombreux réseaux qui relèvent le plus souvent du BCRA ou du Special Operations Executive, les services secrets britanniques. Parfois représentés par quelques hommes seulement, ils sont une trentaine dans l’Orne, une quarantaine dans le Calvados et au moins autant en Seine-Inférieure. Le réseau Alliance connaît une forte extension dans la région, notamment du fait de ses missions de renseignement sur le Mur de l’Atlantique. Les trois principaux réseaux Buckmaster qui opèrent en Normandie sont Jean-Marie-Donkeyman, Prosper-Physician et Hamlet-Salesman.
2.2. En face, de nouveaux acteurs entrent en scène
↑Les désaccords qui opposent depuis plusieurs mois le MBF à ses autorités de tutelle quant au bien-fondé de sa politique de « maintien de l’ordre et de la sécurité » conduisent le Führer à signer un décret transférant les pouvoirs de police des militaires à un Chef supérieur de la police et de la SS (Höherer SS- und Polizeiführer, HSSPF) au printemps 1942. Intronisé par Heydrich à Paris en mai 1942, Carl Oberg prend officiellement ses fonctions en France en juin 1942. Chargé à la fois de la traque des résistants et de la « question juive », il récupère la plupart des effectifs policiers jusqu’ici sous la tutelle du MBF (GFP et personnel administratif du « groupe police » de son état-major administratif), lesquels passent donc sous le contrôle de la Sipo-SD (Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst – police de sûreté et services de renseignements du NSDAP).
En Normandie, ces effectifs sont estimés à 200-250 personnes auxquelles s’ajoutent leurs auxiliaires français, peut-être aussi nombreux. Outre un commandement régional à Rouen (KdS), il existe des antennes pour les cinq départements ainsi que dans les ports du Havre et de Dieppe (en 1944). À Rouen, la rue du Donjon abrite désormais la Sipo-SD dans un immeuble dont les caves servent à l’interrogatoire des prisonniers. Trois membres de la SS se succèdent à la tête de la région : le lieutenant-colonel Rolf Müller, Anton Dauber et le lieutenant-colonel Bruno Müller. L’inspecteur de police judiciaire Louis Alie y a installé son bureau. Ce brillant policier français, anticommuniste forcené et collaborateur zélé, joue un rôle de premier plan dans le démantèlement de la Résistance dans toute la Normandie. Au SD de Caen sévissent deux policiers professionnels, Heinrich Meier puis Harald Heynes. Ils sont épaulés par des collaborateurs français : Raoul Hervé, un garagiste de Saint-Aubin-sur-Mer, et « sa bande », ou encore Lucien Brière. À Alençon, la Sipo-SD s’installe rue de Bretagne sous la direction de Harald Heynes puis de Richard Reinhardt. Elle s’entoure des services de Bernard Jardin, un individu sans conviction politique mais qui réunit autour de lui des désœuvrés criminels. À Évreux, le SD qui s’installe en avril 1942 est sous l’autorité de Walter Kunrede, un professeur de géographie de l’université de Hambourg, nazi convaincu. Il est remplacé en 1944 par Helmut Heineck. De nombreuses infiltrations que l’on doit à un certain « Georgius » donnent lieu à des exécutions et à des arrestations. Au KdS de Cherbourg, Richard Reinhard dirige le SD avant de rejoindre Alençon. Un certain Arthur (ou Ernst) Junger dirige l’antenne de Saint-Lô avant de céder la place à Dorcher, fin 1943.
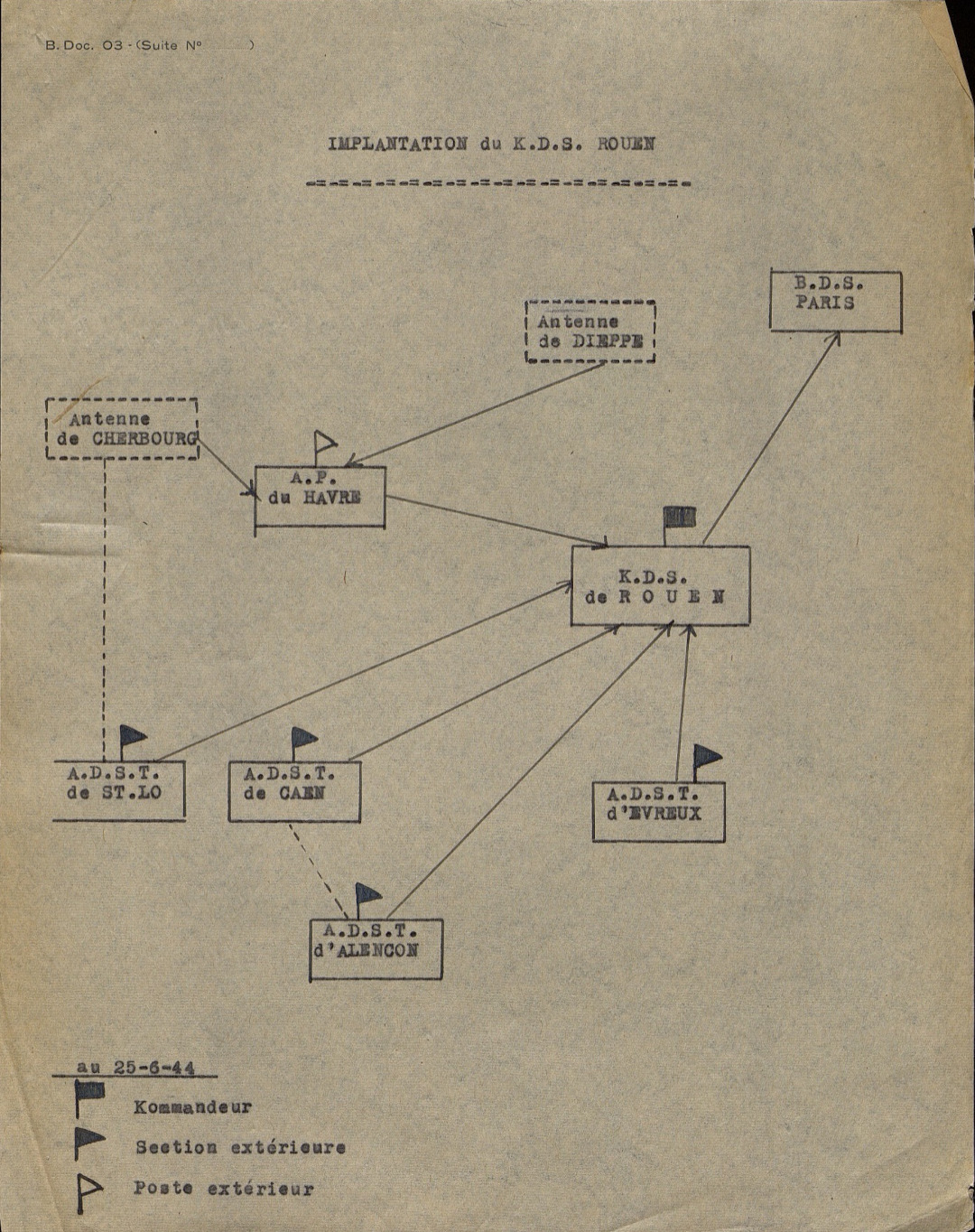
Le gouvernement de Vichy n’est pas en reste pour renforcer son appareil répressif. Entre le 19 avril et le 17 juillet 1941, pas moins de onze lois et décrets, construits autour de l’étatisation de tous les services de police sous l’autorité du ministère de l’Intérieur, bouleversent l’organisation de la police. En même temps qu’ils « sortent la police du giron municipal », ces textes viennent préciser les pouvoirs de police des nouveaux préfets de régions et de leurs intendants de police. En Normandie, le maintien de l’ordre est désormais sous l’autorité du préfet de Région (René Bouffet en 1941-42, André Parmentier en 1942-44, Louis Dramard en 1944) dont les services sont toutefois tenus de coopérer, ce qui n’ira pas sans tiraillements, avec ceux de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), autrement dit : la police judiciaire et notamment la redoutable 3e brigade mobile du commissaire Dargent, le Renseignement général dirigé par le commissaire Duboc, mais aussi la Sécurité publique sous les ordres du commissaire Dussaule puis du commissaire Bartoli. Les brigades mobiles de la Police judiciaire se dotent enfin de compétence à caractère politique avec des sections spécialisées pour les « menées antinationales » ou la persécution des juifs. Rouen joue désormais un rôle de première importance dans les prises de décision quant à la répression dans la région et les collaborations avec les polices allemandes.
2.3. Le judéo-bolchevique : voilà l’ennemi !
↑L’invasion de l’URSS par l’Allemagne, suivie de près par l’entrée en application du décret NN, marque une rupture décisive. Le nouveau dispositif répressif allemand, mis en place par le MBF dès l’été 1941 et adopté par la Sipo-SD en juin 1942, s’appuie désormais sur deux instruments principaux.
2.3.1. Dans les prétoires
↑Le premier d’entre eux demeure judiciaire. Les tribunaux militaires conservent en effet un rôle de premier plan dans la répression des oppositions et sont pleinement intégrés au dispositif répressif dirigé par la Sipo-SD à partir de l’été 1942.
Les sanctions pénales s’aggravent entre l’automne 1941 et la fin de l’été 1942 en
cas de détention d’armes et, à partir du début de l’année 1942, à l’encontre des résistants.
En Normandie, 22 condamnations à mort sont prononcées pour détention d’arme, parfois
combinée à un délit de droit commun. Dénoncé par un voisin, Eugène Caudebec  est arrêté le 19 mars 1942 pour détention d’armes françaises et allemandes. Il meurt
fusillé au stand de tir du Grand-Quevilly, le 13 avril 1942. Le tribunal de la FK
d’Évreux condamne à la même peine Joseph Devaux
est arrêté le 19 mars 1942 pour détention d’armes françaises et allemandes. Il meurt
fusillé au stand de tir du Grand-Quevilly, le 13 avril 1942. Le tribunal de la FK
d’Évreux condamne à la même peine Joseph Devaux  qui avait été interpellé par la gendarmerie de Pont-Audemer pour une tentative de
meurtre avec une arme allemande avant d’être transféré aux autorités allemandes. Dans
la Manche, Marcel Delanois
qui avait été interpellé par la gendarmerie de Pont-Audemer pour une tentative de
meurtre avec une arme allemande avant d’être transféré aux autorités allemandes. Dans
la Manche, Marcel Delanois  a réuni un stock d’armes et en parle à un ami qui le dénonce. Il est arrêté le 1er
octobre 1941 et condamné à mort le 14 mars 1942 par la FK
de Saint-Lô. Mentionnons encore Louis Berrier
a réuni un stock d’armes et en parle à un ami qui le dénonce. Il est arrêté le 1er
octobre 1941 et condamné à mort le 14 mars 1942 par la FK
de Saint-Lô. Mentionnons encore Louis Berrier  . Arrêté par la Feldgendarmerie le 15 juillet 1941 pour avoir renvoyé en Angleterre un pigeon voyageur parachuté
dans sa cage d’osier, il est fusillé un mois plus tard.
. Arrêté par la Feldgendarmerie le 15 juillet 1941 pour avoir renvoyé en Angleterre un pigeon voyageur parachuté
dans sa cage d’osier, il est fusillé un mois plus tard.
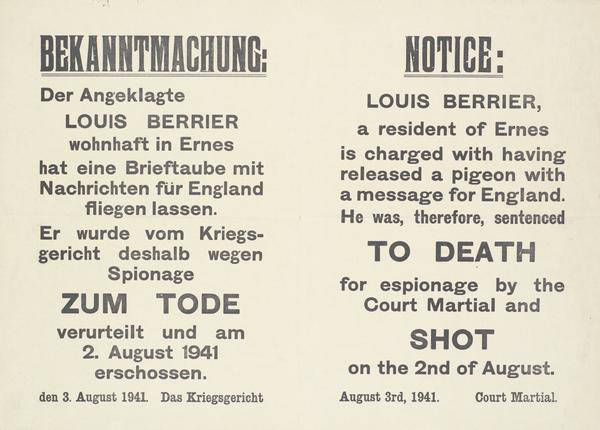
Une nouvelle bascule intervient au printemps 1942. Dès lors, et ce jusqu’à la fin de l’Occupation, les résistants communistes, arrêtés le plus souvent par la police française, font figure de principales victimes des tribunaux militaires allemands : ceux de la branche politique d’abord puis, à partir de l’automne 1942, de la branche armée.
En Normandie, depuis l’Entre-deux-guerres, le Parti communiste s’était particulièrement implanté dans les régions industrielles de Rouen : Elbeuf et les banlieues de l’industrie pétrolière des bords de Seine. Ces territoires figurent, avec les dockers des ports du Havre ou de Cherbourg, parmi les bastions communistes les plus importants de la région. Dans une moindre mesure, Caen, Évreux et Argentan comptent aussi dans les entreprises locales quelques cellules et quelques syndicats actifs, lesquels avaient montré leur détermination lors des grandes grèves de 1936. L’interdiction du Parti communiste après la signature du Pacte germano-soviétique et la déclaration de guerre à l’Allemagne n’ont pas mis fin à l’engagement politique de nombre de militants, politiques ou syndicalistes. Après l’invasion de l’URSS, ils sont nombreux à ne plus se contenter de diffuser de la propagande hostile à Vichy et à s’engager résolument dans la lutte armée au sein de l’Organisation secrète puis du Front national. À leur actif figurent des attentats contre des personnes, des atteintes aux biens de l’armée allemande, des sabotages ferroviaires et industriels, l’élaboration de caches d’armes, etc.
Les premiers à être jugés appartiennent toutefois à la branche politique du parti communiste clandestin. Fichés par les Renseignements généraux dans le fameux « carnet B » depuis les années 1930, les « sympathisants » du Parti s’avèrent faciles à localiser…
Diffuser des tracts communistes est désormais un motif de condamnation à mort. Plus
d’une cinquantaine d’arrestations sont effectuées pour ce motif durant l’été 1941.
À Blainville-sur-Orne dans le Calvados, Maurice Hébert  est jugé pour détention de tracts communistes et fusillé en décembre 1941 à la caserne
du 43e régiment d’infanterie à Caen. Dans l’Eure, un réseau de distribution de tracts
est entièrement démantelé au sanatorium de la Musse. Proches du Front national, ces
résistants s’étaient imprudemment faits remarqués en manifestant le 1er mai 1941.
En mars de l’année suivante, le groupe est interpellé et jugé à la FK
517 de Rouen. Arnaud Salmabide
est jugé pour détention de tracts communistes et fusillé en décembre 1941 à la caserne
du 43e régiment d’infanterie à Caen. Dans l’Eure, un réseau de distribution de tracts
est entièrement démantelé au sanatorium de la Musse. Proches du Front national, ces
résistants s’étaient imprudemment faits remarqués en manifestant le 1er mai 1941.
En mars de l’année suivante, le groupe est interpellé et jugé à la FK
517 de Rouen. Arnaud Salmabide  est fusillé 18 mai 1942 à Évreux au lieu-dit Le Long Buisson avec ses trois camarades,
Bernard Démare,
est fusillé 18 mai 1942 à Évreux au lieu-dit Le Long Buisson avec ses trois camarades,
Bernard Démare,  Jean Gatinel
Jean Gatinel  et Alexandre Le Clec’h
et Alexandre Le Clec’h  . Pierre Gourlaouen
. Pierre Gourlaouen  est, quant à lui, déporté vers la prison de Dietz à la suite de ce même jugement.
Dans l’Orne, le 18 octobre, une vague d’arrestations touche la région de Flers, Tinchebray
et Vassy. La GFP arrête notamment Joseph Bacco
est, quant à lui, déporté vers la prison de Dietz à la suite de ce même jugement.
Dans l’Orne, le 18 octobre, une vague d’arrestations touche la région de Flers, Tinchebray
et Vassy. La GFP arrête notamment Joseph Bacco  , Henri Véniard
, Henri Véniard  et Maurice Hochet
et Maurice Hochet  suite à une distribution massive de tracts. Henri Véniard est condamné à mort pour
« intelligence avec l’ennemi » et fusillé, les autres sont déportés après avoir été
acquittés.
suite à une distribution massive de tracts. Henri Véniard est condamné à mort pour
« intelligence avec l’ennemi » et fusillé, les autres sont déportés après avoir été
acquittés.
2.3.2. La politique des otages
↑2.3.2.1. Les exécutions, de septembre 1941 à septembre 1942
↑Mais si la répression allemande connaît un tournant idéologique majeure au lendemain de l’invasion de l’URSS par l’Allemagne et de l’engagement du parti communiste clandestin dans la lutte armée, c’est aussi et surtout au travers de la « politique des otages ». Le dispositif judiciaire se double de mesures extra-judiciaires dont les femmes sont cette fois exclues et qui cible spécifiquement l’ennemi « judéo-bolchevique ».
La procédure est réglementée par le MBF au lendemain de l’assassinat, à Paris, de l’aspirant de marine Alfons Moser par Pierre Georges, un jeune militant communiste des Bataillons de la jeunesse, le 21 août 1941. Le 28 septembre 1941, le Commandant militaire allemand Otto von Stülpnagel diffuse auprès de ses services un « code des otages » qui prévoit les catégories de détenus à porter sur les listes de personnes destinées à « expier » les attentats : les membres d’organisations communistes ou anarchistes d’abord, les « personnes récemment arrêtées à la suite d’actes de terreur ou de sabotage en raison de leurs relations avec l’entourage des auteurs présumés desdits actes », enfin les gaullistes. N’y figurent pas encore explicitement les Juifs, ce qui ne les empêchera pas d’être immédiatement ciblés.
La procédure est appliquée à partir de l’automne 1941 et consiste à fusiller des otages en représailles des attentats commis contre l’occupant. Le MBF rompt dès lors avec la pratique traditionnelle de la prise d’otages. Il décide en effet de ne pas prélever les otages destinés à être fusillés en cas d’attentats parmi les notables, mais parmi le « cercle des coupables présumés », c’est-à-dire, en pratique, parmi les détenus communistes et bientôt juifs.
En Normandie, les premières fusillades d’otages ont lieu en décembre. Incarcérés à
la prison de Beaulieu dans le quartier de la Maladrerie, ces hommes n’ont pas nécessairement
de lien avec la région. Proche de Paris, cette prison est en effet réservée et aménagée
pour les longues peines. Le 15 décembre 1941, les autorités allemandes y prélèvent
treize communistes arrêtés par la police française et condamnés aux travaux forcés
par la Section spéciale de Paris. Lucien Sampaix  ou encore Joseph Di Fusco
ou encore Joseph Di Fusco  [9] 9. J.-A. di Fusco, (…) figurent parmi les victimes de ces premières exécutions d’otages en Normandie. Michel Farré,
[9] 9. J.-A. di Fusco, (…) figurent parmi les victimes de ces premières exécutions d’otages en Normandie. Michel Farré,  un jeune communiste de Mondeville, est le seul Normand. D’autres sont exécutés au
Mont-Valérien, à Suresnes, comme Marcel Fézandelle
un jeune communiste de Mondeville, est le seul Normand. D’autres sont exécutés au
Mont-Valérien, à Suresnes, comme Marcel Fézandelle  du Trait (Seine-Inférieure) et Désiré Pucet
du Trait (Seine-Inférieure) et Désiré Pucet  de Sainte-Marthe dans l’Eure.
de Sainte-Marthe dans l’Eure.

Réciproquement, plusieurs attentats commis en Normandie donnent lieu à des exécutions d’otages dans d’autres régions… Ceux perpétrés à Elbeuf le 21 janvier 1942 et à Rouen le 4 février 1942 se soldent ainsi par l’exécution de vingt otages. Trois semaines plus tard, vingt détenus sont passés par les armes en représailles de l’attentat du 23 février 1942 au Havre. Ce jour-là, un jeune groupe de résistants communistes avait lancé une grenade sur un détachement de marins allemands, place de l’Arsenal. Deux soldats furent blessés. Une rafle effectuée le jour même sur les lieux de l’attentat et le lendemain dans les milieux communistes conduisit à de nombreuses interpellations. Le 5 avril, le Journal de Rouen publie l’avis du Chef régional de l’administration militaires allemande : « malgré ma demande, les auteurs de cette attaque si lâche sont restés inconnus (…) comme je l’ai menacé l’autre jour, la fusillade a été exécutée aujourd’hui, Saint-Germain-en-Laye, 31 mars 1942 ».
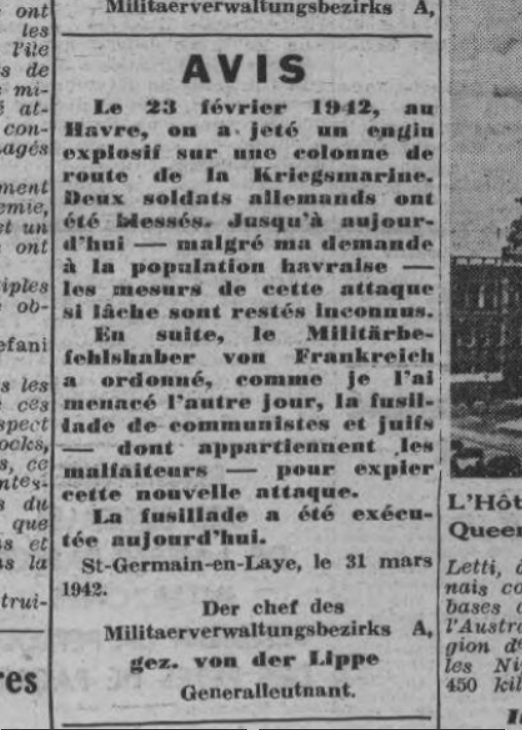
L’attentat perpétré le 21 janvier 1942 par deux cyclistes à Saint-Aubin-lès-Elbeuf,
en banlieue de Rouen, provoque la mort de quatre marins… Vingt personnes, tous militants
communistes, sont portées sur la liste des otages à exécuter. Neuf sont fusillés à
Caen dont plusieurs Juifs, parmi lesquels se trouve Judas Eidelman  mais aussi Joseph Le Clainche
mais aussi Joseph Le Clainche  [10] 10. L. Poulhès, « L (…) .
[10] 10. L. Poulhès, « L (…) .
Les fusillades en représailles des attentats d’Airan [11] 11. J. Quellien, Ré (…) commis les 15 et 16 avril 1942 et dans la nuit du 30 avril au 1er mai, figurent parmi les plus importantes de la région. Aux yeux des Allemands, la
mort de 38 soldats et les centaines de blessés occasionnées lors de ces déraillements
de trains opérés par une poignée de résistants FTP
sur la ligne Maastricht-Cherbourg, ne peuvent rester impunis. Le 30 avril 1942, vingt-quatre
exécutions sont ordonnées en France suite au premier attentat de Moult-Argences :
à Amiens, Vannes, Tours, Auxerre et Caen, où Jean Surmatz  et Louis Bouillard
et Louis Bouillard  sont passés par les armes. Les 9 et 12 mai, 28 otages sont fusillés, cette fois en
« expiation » du sabotage commis le 1er mai, dont Henri Donnet,
sont passés par les armes. Les 9 et 12 mai, 28 otages sont fusillés, cette fois en
« expiation » du sabotage commis le 1er mai, dont Henri Donnet,  à Rouen, Pierre Mangel
à Rouen, Pierre Mangel  et Pierre Faurès
et Pierre Faurès  à Caen.
à Caen.

Le MBF espérait ainsi effrayer les résistants
potentiels et « les terroristes » mais aussi convaincre les Français que la répression
ne frappait qu’une minorité d’individus présentant un profil politique et racial spécifique.
Après le transfert des pouvoirs de police à un HSSPF, la Sipo-SD
reprend à son compte les grandes lignes de la « politique de otages » du MBF. Mais au lieu d’ordonner des exécutions d’otages à intervalles
rapprochés à la suite de chaque attentat, Oberg préfère les regrouper et leur donner
un caractère massif pour en accentuer l’effet dissuasif. La dernière fusillade témoigne
de cette volonté de marquer les esprits. Le 21 septembre 1942, 116 otages sont exécutés
au Mont-Valérien et à Bordeaux. Des Normands figurent parmi les victimes de Suresnes :
Roger Bastion  de Caen, Achille Mesnil
de Caen, Achille Mesnil  de Cherbourg, Marcel Champion
de Cherbourg, Marcel Champion  de Mesnil-Maugis dans l’Orne, Noël David
de Mesnil-Maugis dans l’Orne, Noël David  d’Évreux, ou encore Henri Aubergier
d’Évreux, ou encore Henri Aubergier  de Rouen.
de Rouen.
Au total, 204 otages ont été fusillés entre juin 1942 et septembre 1942 sur ordre du HSSPF dans le ressort du MBF, ce qui porte le bilan de la politique des exécutions d’otages mises en œuvre entre septembre 1941 et septembre 1942 à 734 victimes.
2.3.2.2. Les déportations « expiatoires »
↑Suite au démantèlement de plusieurs groupes résistants auxquels sont attribués la plupart des attentats commis entre juin et septembre 1942, et surtout pour des raisons pragmatiques liées au recrutement de la main d’œuvre programmé par la première « action Sauckel » que les exécutions d’otages risquaient de venir compliquer, le HSSPF décide cependant de renoncer à la « politique des otages » telle qu’elle était conçue jusqu’ici.
Les arguments avancés par la Sipo-SD pour mettre fin aux exécutions massives d’otages ne sont pas nouveaux. Jugeant ces fusillades inefficaces car incapables d’effrayer les « terroristes » – pour qui le sacrifice et la provocation d’un cycle « attentats/représailles » seraient devenus une arme de guerre –, et surtout contre-productives au regard des risques qu’elles feraient courir à la Collaboration, le MBF les martèle à ses supérieurs depuis plus d’un an déjà. Et s’il a échoué en son temps à convaincre Berlin de mettre fin à ces bains de sang en cas d’attentat, il a toutefois réussi, dès la fin de l’année 1941, à doter la « politique des otages » d’une nouvelle procédure, destinée à substituer à ces fusillades massives des exécutions plus limitées, mais associées à la déportation de « grandes masses » d’otages juifs et communistes.
Ainsi, la répression des attentats d’Airan ne se solde pas seulement par des exécutions. Dans le Calvados, 120 otages juifs, communistes ou gaullistes sont internés à Compiègne en vue de leur déportation à la suite de ces actions. La majorité d’entre eux monte dans un des wagons du convoi du 6 juillet 1942 [12] 12. C. Cardon-Hamet (…) . Les 21 et 22 octobre 1941, une rafle est menée par les forces de l’ordre françaises dans toutes les banlieues industrielles en Seine-Inférieure : Le Petit et le Grand Quevilly, Sotteville-lès-Rouen, Darnétal, Notre-Dame-de-Gravenchon, Le Trait, Le Havre, etc. Il ne s’agit ni plus ni moins de constituer « une réserve d’otages ». Près d’une centaine de communistes rejoignent les geôles improvisées dans la caserne Hatry ou les cellules de la prison Bonne Nouvelle.

Arrêtés à cette occasion, Albert Champin  , Marcel Genvrin
, Marcel Genvrin  et Lucien Pelletier
et Lucien Pelletier  sont livrés aux Allemands qui les transfèrent au camp de transit de Royallieu à Compiègne,
dans l’attente de leur déportation « expiatoire » vers Auschwitz, le 6 juillet 1942.
D’autres, environ une quarantaine, restent en prison jusqu’à leur départ en janvier
1943 vers les KL de Sachensenhausen.
Ce fut le cas de Gustave Pimont
sont livrés aux Allemands qui les transfèrent au camp de transit de Royallieu à Compiègne,
dans l’attente de leur déportation « expiatoire » vers Auschwitz, le 6 juillet 1942.
D’autres, environ une quarantaine, restent en prison jusqu’à leur départ en janvier
1943 vers les KL de Sachensenhausen.
Ce fut le cas de Gustave Pimont  . Restés eux aussi en prison jusque-là, une vingtaine de Manchois arrêtés en juin,
septembre et octobre 1941 à Cherbourg ou Saint-Lô, montent également à bord du convoi
du 6 juillet 1942 : les militants communistes Édouard Lechevalier
. Restés eux aussi en prison jusque-là, une vingtaine de Manchois arrêtés en juin,
septembre et octobre 1941 à Cherbourg ou Saint-Lô, montent également à bord du convoi
du 6 juillet 1942 : les militants communistes Édouard Lechevalier  et Lucien Levaufre
et Lucien Levaufre  figurent parmi eux. Au total, 216 personnes arrêtées en Normandie sont déportées
dans ce convoi. Intercalé entre les convois de déportés juifs n° 5 et 6, ce « convoi-représailles »
est composé d’environ 1 175 hommes, majoritairement communistes. Formé par le MBF, le convoi part sous la houlette de la Sipo-SD, à laquelle les pouvoirs de police viennent d’être transférés.
figurent parmi eux. Au total, 216 personnes arrêtées en Normandie sont déportées
dans ce convoi. Intercalé entre les convois de déportés juifs n° 5 et 6, ce « convoi-représailles »
est composé d’environ 1 175 hommes, majoritairement communistes. Formé par le MBF, le convoi part sous la houlette de la Sipo-SD, à laquelle les pouvoirs de police viennent d’être transférés.
2.4. Le décret NN
↑2.4.1. Aux prémices du décret NN : l’affaire Porto
↑À l’automne 1941, les services de l’Abwehr mettent en œuvre l’opération « Porto » [13] 13. T. Fontaine, Dé (…) dont l’objectif est le démantèlement d’un des premiers réseaux de résistants d’ampleur
nationale : le réseau Hector. Sous l’autorité de Joseph Placke, un SS
détaché de Paris, plus de 900 personnes sont interpellées dont 720 en France occupée.
En Normandie, l’opération donne lieu à une trentaine d’interpellations. Contrairement
aux procédures appliquées jusqu’ici, les détenus sont interrogés en France mais ils
sont ensuite rapidement transférés vers le Reich pour y être jugés. Faute de preuves,
une vingtaine d’entre eux sont libérés du camp d’Hinzert en août 1942, tels Louis Borderieux  , originaire du Calvados, Édouard Lair
, originaire du Calvados, Édouard Lair  et ses deux fils Pierre
et ses deux fils Pierre  et Robert
et Robert  , domiciliés à Louviers dans l’Eure, mais aussi Yves Baudouin
, domiciliés à Louviers dans l’Eure, mais aussi Yves Baudouin  de Carteret. Le père Boulogne
de Carteret. Le père Boulogne  , curé à Saint-André-de-l’Eure, ne revient pas du camp de Sachsenhausen. Les autres
recouvrent la liberté en avril ou mai 1945.
, curé à Saint-André-de-l’Eure, ne revient pas du camp de Sachsenhausen. Les autres
recouvrent la liberté en avril ou mai 1945.
2.4.2. Le décret NN
↑Une nouvelle forme de déportation vient compléter l’arsenal judiciaire allemand en décembre 1941. Jugeant la justice militaire en France occupée trop lente et trop peu dissuasive, Hitler et Keitel décident de la doter d’une nouvelle arme en promulguant un décret aujourd’hui connu sous le nom de « décret NN ». Celui-ci dispose que les auteurs d’actes menaçant gravement la sécurité de la puissance occupante ou du Reich ne devront être jugés en territoire occupé que si leur condamnation à mort paraît assurée et susceptible d’être prononcée et exécutée « avec le minimum de diligence ». Les autres seront transférés en Allemagne pour y être soumis à une juridiction militaire ou civile. Pour renforcer l’effet d’intimidation de la procédure, toutes les demandes de renseignements quant au sort des déportés devaient être rejetées. Ainsi, les prévenus disparaîtraient dans la « nuit et brouillard » (Nacht und Nebel), laissant leur entourage dans l’ignorance de leur sort.
Son application conduit, entre mai 1942 – départ des premiers convois – et juin 1943, à la « déportation NN » de près de 1200 suspects. En Normandie, environ 150 détenus sont acheminés vers Hinzert, un camp géré par les SS où transitent la plupart des déportés NN en attendant leur éventuel jugement.
La procédure est principalement appliquée aux résistants non-communistes et aux résistants de la branche politique du PCF, quand ceux-ci n’ont pas été laissés aux bons soins de la police française selon les accords Bousquet-Oberg. En effet, ces accords ont scellé, à la fin de l’été 1942, le renforcement de la collaboration entre les polices allemande et française contre leurs ennemis communs, en échange d’une augmentation des moyens humains et matériels accordés aux forces de l’ordre françaises et surtout d’un rétablissement en trompe l’œil de la souveraineté de l’appareil répressif français en zone occupée. Sur le terrain, l’inspecteur de la police judiciaire de la Région de Rouen, Louis Alie, incarne parfaitement ces nouveaux accords. Inspecteur brillant, il se rapproche très vite de la Sipo-SD avec laquelle il travaille de façon extrêmement efficace. On lui doit le démantèlement de nombreux réseaux ou mouvements dans la région. Il apparaît même – à moins qu’à la Libération sa hiérarchie cherche à se dédouaner – comme un électron libre qui ne reçoit ses ordres que des Allemands.
Parmi les principales victimes du décret NN figurent également
une grande partie des civils accusés de détention d’arme. Originaires de Landisacq
dans l’Orne, Joseph Bazin  et son fils Marcel
et son fils Marcel  sont dénoncés pour détentions d’armes à feu et sont déportés NN
à Hinzert, en mai 1943. Dans le Calvados, le Dictionnaire recense 25 détenus déportés
dans ce camp pour détention d’armes, dont la majorité meurt en Allemagne, comme Jean-Baptiste Barbault
sont dénoncés pour détentions d’armes à feu et sont déportés NN
à Hinzert, en mai 1943. Dans le Calvados, le Dictionnaire recense 25 détenus déportés
dans ce camp pour détention d’armes, dont la majorité meurt en Allemagne, comme Jean-Baptiste Barbault  de Vernon décédé au KL Gross
Rosen. En Seine-Inférieure, on dénombre dix-sept arrestations pour le même motif.
Quatorze sont enregistrées dans la Manche. Arrêtés puis déportés dans ce cadre, Bienaimé Brunet
de Vernon décédé au KL Gross
Rosen. En Seine-Inférieure, on dénombre dix-sept arrestations pour le même motif.
Quatorze sont enregistrées dans la Manche. Arrêtés puis déportés dans ce cadre, Bienaimé Brunet  du Mesnil et Victor Durand
du Mesnil et Victor Durand  de Parigny ne reviennent pas. Paul Luce
de Parigny ne reviennent pas. Paul Luce  figure quant à lui parmi les NN rescapés.
figure quant à lui parmi les NN rescapés.
Les communistes engagés dans la lutte armée continuent en revanche à être massivement jugés et condamnés à mort en zone occupée.
2.4.3. Les déportations carcérales
↑Pour renforcer l’effet dissuasif des jugements de ses tribunaux dans un contexte jugé particulièrement tendu en France occupée, mais aussi désengorger les prisons de son ressort, le MBF ordonne par ailleurs le transfert de catégories de plus en plus nombreuses de condamnés vers les établissements pénitentiaires du Reich. La mesure touche près de 1 750 personnes entre le mois de juin 1941 et la fin du mois de mai 1943 [14] 14. Données tirées (…) .
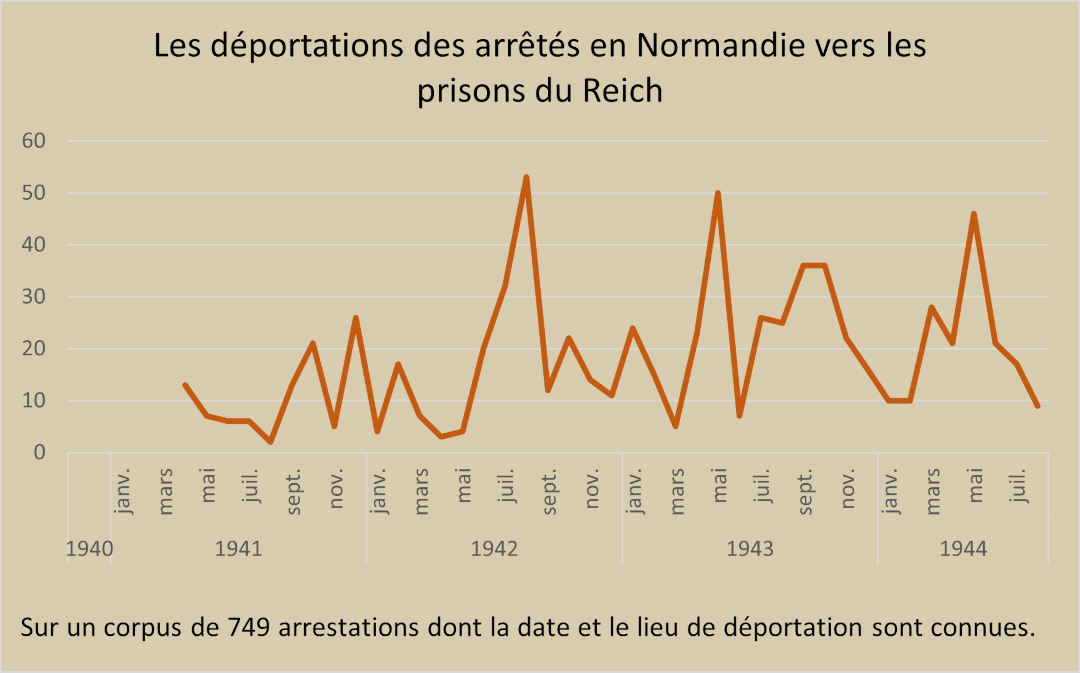
2.5. La mise en œuvre de la « solution finale »
↑En Normandie, les communautés juives vivent surtout dans les villes. Mais parce qu’ils sont menacés depuis l’invasion de 1940, des Juifs originaires d’autres régions, de Paris surtout, se réfugient aussi dans les campagnes normandes, espérant ainsi, a minima, un certain répit.
Depuis 1941 pourtant, des Juifs sont arrêtés en Normandie. Du fait de leur nationalité
russe d’abord (cf supra). D’autres sont la cible de la « politique des otages » comme à Rouen et à Elbeuf,
où plus de 70 hommes sont raflés dans la nuit du 6 au 7 mai 1942 suite à un attentat
commis contre des militaires allemands à Rouen. Parmi eux, figurent tous les hommes
de la famille Ettinger, établie à Rouen depuis les années 1920. Pinkus  , Nathan
, Nathan  , Jacques
, Jacques  , Henri
, Henri  et Albert
et Albert  , naturalisés ou de nationalité française, sont ensuite internés à Drancy. Ils sont
déportés à Auschwitz le mois suivant.
, naturalisés ou de nationalité française, sont ensuite internés à Drancy. Ils sont
déportés à Auschwitz le mois suivant.
Mais à partir de l’été 1942, les convois composés exclusivement de Juifs répondent à une tout autre logique. La politique des autorités d’occupation à laquelle souscrit le gouvernement de Vichy prend une toute autre forme : hommes, femmes et enfants sont rassemblés dans des camps d’internement (Drancy, Beaune-la-Rolande, Pithiviers) en vue de leur déportation vers les camps d’extermination. Le plus souvent, les ordres viennent de Paris mais une antenne de la Police aux questions juives sous la houlette de son délégué régional, André Coulon, s’avère particulièrement active pour traquer les Juifs en Normandie.
De juin à octobre 1942, de très nombreux convois partent de France, emportant plus
de 35 000 Juifs vers les camps d’extermination. En Normandie, environ 28% des Juifs
déportés l’ont été entre juillet et novembre 1942. Désormais, femmes et enfants font
partie des convois. Des Juifs Français ou naturalisés français aussi, tels les enfants
Kirzner  domiciliés à Caen. Les enfants Ettinger
domiciliés à Caen. Les enfants Ettinger  , dont les pères et frères étaient déjà internés, connaissent un sort identique. La
famille d’origine roumaine Bonnem
, dont les pères et frères étaient déjà internés, connaissent un sort identique. La
famille d’origine roumaine Bonnem  qui réside à Alençon, mais aussi les Goldenberg
qui réside à Alençon, mais aussi les Goldenberg  de Granville ou encore le couple Aszendorf
de Granville ou encore le couple Aszendorf  de nationalité polonaise domicilié à Évreux n’échappent pas non plus à la déportation.
de nationalité polonaise domicilié à Évreux n’échappent pas non plus à la déportation.
Pour les populations juives résidant en Normandie, c’est toutefois l’année 1943 qui,
contrairement à ce qui se produit à l’échelle nationale, s’avère être la plus meurtrière.
46 % des arrestations ont lieu cette année-là. Sous couvert d’une opération de représailles
faisant suite à un nouvel attentat commis le 2 janvier contre un officier de la Feldkommandantur, la Sipo-SD de Rouen ordonne
« de liquider le département de ses Juifs ». Des rafles massives conduisent plus de
180 personnes dans les camps de la mort en février et mars 1943. La plupart d’entre
elles ont été arrêtées dans la nuit du 15 au 16 janvier 1943 à Rouen et dans sa région.
Orchestrées par le Secrétaire général de la préfecture, Jean Spach, les opérations
sont menées en toute discrétion [15] 15. F. Bottois, De (…) . Deux fillettes de la famille Ettinger, Lisa  et Odette
et Odette  , mais aussi Berthe,
, mais aussi Berthe,  Michèle
Michèle  et Annie Erdelyi
et Annie Erdelyi  sont rassemblées avec des dizaines d’autres victimes dans un centre d’internement
rue Poisson à Rouen, avant de rejoindre Drancy puis les chambres à gaz d’Auschwitz.
Enfants d’un prisonnier de guerre français, Claude
sont rassemblées avec des dizaines d’autres victimes dans un centre d’internement
rue Poisson à Rouen, avant de rejoindre Drancy puis les chambres à gaz d’Auschwitz.
Enfants d’un prisonnier de guerre français, Claude  et Colette Tcherkawsky
et Colette Tcherkawsky  figurent parmi les rares rescapés.
figurent parmi les rares rescapés.
2.6. Pallier les besoins de main-d’œuvre par des déportations massives : l’opération meerschaum
↑Avec le basculement de l’Allemagne nazie dans la guerre totale, les enjeux de réquisition de main-d’œuvre deviennent aussi déterminants que le maintien de l’ordre dans les territoires occupés. Le 14 décembre 1942, Himmler demande aux organismes policiers du Reich et des territoires occupés l’envoi dans les camps de concentration de 35 000 « détenus aptes au travail ». Les besoins d’approvisionnement du système concentrationnaire en travailleurs forcés mis au service de l’économie de guerre allemande conduisent au départ des premiers convois massifs de détenus que la Sipo-SD est autorisée, depuis l’automne 1942, à transférer directement vers les camps de concentration du Reich en dehors de toute procédure judiciaire.
Durant la première moitié de l’année 1943, les convois organisés dans le cadre de l’opération Meerschaum entraînent le départ vers le système concentrationnaire de près de 7 000 détenus, dont 322 l’étaient en Normandie. Ils n’en demeurent pas moins exceptionnels à ce stade et ne modifient pas fondamentalement la « norme répressive » appliquée par l’occupant en France occupée depuis l’été 1941. Certes, ces déportations massives réduisent le rôle joué par les tribunaux militaires et les classements « NN » dans la répression de la Résistance. Pour autant, peu de résistants et de résistantes, et encore moins de résistants ou de résistantes de premier plan sont déportés dans le cadre de cette opération. Il s’agit surtout d’individus ayant contrevenu aux lois sur le travail.
| Date (1943) | KL | Nombre de déportés |
|---|---|---|
| 24 janvier | Sachenhausen | 131 |
| 16 avril | Mauthausen | 34 |
| 20 avril | Mauthausen | 60 |
| 28 avril | Sachenhausen | 11 |
| 8 mai | Sachenhausen | 16 |
| 25 juin | Buchenwald | 70 |
À la même période toutefois, 42 détenus sont encore victimes en Normandie de déportations
judiciaires, via le camp SS d’Hinzert. Les résistants considérés
comme les plus dangereux continuent en effet à faire l’objet de procédures ciblées,
qu’ils soient déportés dans le cadre de la procédure « NN »
ou jugés en France par les tribunaux militaires allemands. Originaire du Mesnil dans
la Manche, Bienaimé Brunet  est déporté NN dans un petit convoi, le 18 février 1943,
aux côtés de 38 autres détenus. Manchois lui aussi, Jacques Bazin
est déporté NN dans un petit convoi, le 18 février 1943,
aux côtés de 38 autres détenus. Manchois lui aussi, Jacques Bazin  quitte la gare de l’Est le 25 février 1943 dans un wagon cellulaire du train Paris-Berlin,
avec 27 autres camarades. Tous deux avaient été arrêtés pour « détention d’armes ».
quitte la gare de l’Est le 25 février 1943 dans un wagon cellulaire du train Paris-Berlin,
avec 27 autres camarades. Tous deux avaient été arrêtés pour « détention d’armes ».
À ces deux procédures ciblées s’en ajoute cependant une nouvelle, extrajudiciaire
cette fois. La Sipo-SD commence
en effet, à compter du printemps 1943, à utiliser le classement « NN » pour déporter, dans de petits convois, des détenus jugés particulièrement
dangereux – cadres de la Résistance en particulier – vers les camps de concentration
du Reich sans intervention des tribunaux militaires et sans perspective de jugement
devant une juridiction allemande. Parmi les 35 hommes entassés le 21 janvier 1943
dans un wagon cellulaire en partance pour le camp d’Hinzert, quatorze sont normands.
Figurent notamment parmi eux Robert Berzin  et Lucien Brunard
et Lucien Brunard  , mais aussi André Tricot
, mais aussi André Tricot  , des résistants du réseau Shelburn.
, des résistants du réseau Shelburn.
3. Juillet 1943-mai 1944 : les déportations massives deviennent la norme
↑Avec le développement de la Résistance et l’enlisement dans la « guerre totale » qui s’accompagne de demandes toujours plus nombreuses d’envois de main-d’œuvre vers le système concentrationnaire, la répression allemande qui visait depuis l’été 1941 principalement les ennemis idéologiques du Reich, communistes et Juifs en particulier, ainsi que tous ceux qui s’en prenaient directement à ses intérêts, change de nature et touche des fractions de plus en plus larges de la population.
Ce tournant majeur s’accompagne d’un rééquilibrage des rôles entre les acteurs policiers et militaires impliqués dans la répression des oppositions en France occupée. La « sécurisation » du territoire relève désormais, côté allemand, de quatre instances principales de commandement : le HSSPF, le MBF, l’OBW (Oberbefehlshaber West - Commandant en chef du front Ouest) et l’OKW (Oberkommando der Wehrmacht - Haut Commandement des Forces Armées), dont les rapports de subordination et les champs de compétences deviennent de plus en plus complexes et opaques, à mesure que la lutte contre les activités de résistance acquiert, aux yeux des Allemands, une dimension qui n’est plus seulement policière, mais aussi et surtout militaire. Reste qu’en cas d’arrestations, c’est bien la Sipo-SD qui continue à maîtriser l’essentiel des aiguillages répressifs.
Entre juillet 1943 et mai 1944, les actions contre la résistance menées aussi bien
par la Sipo-SD et ses auxiliaires
de la police française provoquent de véritables hécatombes. Les policiers pratiquent
l’infiltration des réseaux avec une certaine habileté en retournant nombre de résistants.
S’y ajoutent l’imprudence ou l’inexpérience de jeunes recrues et des interrogatoires
particulièrement musclés qui permettent de faire tomber des réseaux entiers. Au printemps
1944, le réseau Alliance est touché suite à l’infiltration d’un agent double : Lionel
Audiger, Robert Douin  et le colonel De Touchet
et le colonel De Touchet  sont arrêtés. Ils seront exécutés à la prison de Caen en juin 1944. En mai, dans
l’Eure, l’imprudence et la désobéissance d’un jeune agent de liaison conduisent en
camp de concentration plus de 75 personnes : Turma-Vengance n’est plus. Son chef,
Louis Maury
sont arrêtés. Ils seront exécutés à la prison de Caen en juin 1944. En mai, dans
l’Eure, l’imprudence et la désobéissance d’un jeune agent de liaison conduisent en
camp de concentration plus de 75 personnes : Turma-Vengance n’est plus. Son chef,
Louis Maury  , est interpellé avec une vingtaine de camarades dont Charles Madelaine,
, est interpellé avec une vingtaine de camarades dont Charles Madelaine,  René Dauplay
René Dauplay  et Henri Chauvin
et Henri Chauvin  . Le réseau Delbo-Phénix dans la Manche subit lui aussi de plein fouet la redoutable
efficacité des services de police. Valentine Jaffré
. Le réseau Delbo-Phénix dans la Manche subit lui aussi de plein fouet la redoutable
efficacité des services de police. Valentine Jaffré  , Marie
, Marie  et Paul Oursel
et Paul Oursel  sont déportés. En Seine-Inférieure, des chefs du Front National et du CDL sont interpellés : Yves Meyer
sont déportés. En Seine-Inférieure, des chefs du Front National et du CDL sont interpellés : Yves Meyer  et, plus tard, André Mallet
et, plus tard, André Mallet  . Le comité départemental de libération nationale est décapité lui aussi en décembre
1943. Benjamin Remacle,
. Le comité départemental de libération nationale est décapité lui aussi en décembre
1943. Benjamin Remacle,  son président, est arrêté porteur de documents compromettants. Une souricière tendue
par le redoutable inspecteur Alie aidé de la fratrie des Leroux, collaborateurs notoires
à la solde de la Gestapo, permet de faire font tomber le reste des membres : Raoul Leprettre
son président, est arrêté porteur de documents compromettants. Une souricière tendue
par le redoutable inspecteur Alie aidé de la fratrie des Leroux, collaborateurs notoires
à la solde de la Gestapo, permet de faire font tomber le reste des membres : Raoul Leprettre  , René Dragon
, René Dragon  , Etienne Touré
, Etienne Touré  …D’autres chefs sont arrêtés aussi : Jean Thomas
…D’autres chefs sont arrêtés aussi : Jean Thomas  du MNPGD, Edmond Mahieu
du MNPGD, Edmond Mahieu  de l’ORA, Francis Fagot
de l’ORA, Francis Fagot  de l’OCM… En mars 1944, une centaine de membres
du réseau Salesman sont interpellés : Jean
de l’OCM… En mars 1944, une centaine de membres
du réseau Salesman sont interpellés : Jean  et Florentine Sueur
et Florentine Sueur  , Gaston Delbos
, Gaston Delbos  , les maquisards du maquis des Diables noirs, les frères Boulanger, Raoul
, les maquisards du maquis des Diables noirs, les frères Boulanger, Raoul  et Henri
et Henri  , ainsi que leurs épouses, Lucienne
, ainsi que leurs épouses, Lucienne  et Augustine
et Augustine  , etc. Les premiers maquis de l’Orne subissent eux aussi des coups sévères portés
par des collaborateurs acquis à la Collaboration, tels Bernard Jardin et sa bande.
Après l’échec d’un attentat contre un collaborateur, la gendarmerie et les Renseignements
généraux attrapent huit jeunes maquisards. Deux d’entre eux, Charles Dumaine
, etc. Les premiers maquis de l’Orne subissent eux aussi des coups sévères portés
par des collaborateurs acquis à la Collaboration, tels Bernard Jardin et sa bande.
Après l’échec d’un attentat contre un collaborateur, la gendarmerie et les Renseignements
généraux attrapent huit jeunes maquisards. Deux d’entre eux, Charles Dumaine  et André Suriray
et André Suriray  , sont déportés. Les autres sont condamnés à mort et fusillés : Marcel Lemoulan
, sont déportés. Les autres sont condamnés à mort et fusillés : Marcel Lemoulan  , Bernard Montigny
, Bernard Montigny  , Henri
, Henri  et Robert Gagnaire
et Robert Gagnaire  .
.
3.1. Les convois massifs deviennent un instrument essentiel de la répression de la Résistance
↑Jusqu’ici exceptionnelles et ne ciblant pas spécifiquement les résistants, les déportations extrajudiciaires massives de tous les « adversaires » de l’Allemagne vers les camps de concentration du Reich deviennent l’outil répressif principal, sans que ne soient pour autant mis en sommeil les autres instruments répressifs existants, judiciaires en particulier. De septembre 1943 à août 1944, 19 convois, composés le plus souvent d’une vingtaine de wagons de marchandises et d’au moins 1 000 détenus, déportent près de 29 200 personnes, le Débarquement de Normandie ne signant pas la fin des départs. Ainsi, plus de 500 détenus arrêtés en Normandie partent dans ces grands convois aux conditions de transport effroyables, vers Buchenwald, Ravensbrück ou Mauthausen. Le convoi du 27 avril 1944 emporte 1653 détenus vers le KL Auschwitz, dont 123 déportés normands, résistants pour la plupart, avant de rejoindre le camp de Buchenwald.
Si ces déportations en masse de détenus placés préalablement en détention administrative participent de plusieurs programmes de prélèvement de la main d’œuvre destinés à alimenter l’économie de guerre allemande, elles répondent aussi à des objectifs sécuritaires et visent à réprimer les résistants, ceux qui les soutiennent, et ceux qui doivent « expier » leurs crimes. Dans les premiers convois du second semestre 1943, la part des résistants augmente ainsi progressivement, jusqu’à constituer un groupe essentiel dans les transports de janvier 1944. Les convois massifs sont dès lors devenus un instrument essentiel de la répression de la Résistance, dont les victimes sont puisées dans trois réservoirs principaux de détenus : les résistants « gaullistes » et communistes – rattachés essentiellement à la branche politique du PCF –, les raflés victimes de représailles imposées à la population dans le cadre de la « lutte contre les bandes », enfin les détenus condamnés par les sections spéciales françaises et livrés par Vichy, majoritairement communistes, dont la déportation a été décidée préventivement au début de l’année 1944. La majorité des résistants arrêtés sont désormais déportés dans ces convois massifs.
3.2. Le maintien de procédures plus ciblées
↑Cependant, la Sipo-SD continue à opérer un tri entre les résistants et à leur appliquer, en fonction de la lecture de leur dossier et des impératifs du moment, un certain nombre de procédures plus ciblées. Ceci explique que des suspects, arrêtés dans le cadre d’une même affaire, puissent être victimes de procédures de nature différente.
La première d’entre elles vise des résistants placés en détention administrative que
la Sipo-SD a choisi de ne plus
renvoyer devant la justice militaire qui en avait jusqu’ici principalement la charge,
mais qu’elle juge néanmoins trop dangereux pour être déportés dans les convois massifs.
Classés « NN Gestapo », ces cadres de la Résistance, parmi lesquels de nombreux membres de groupes armés
ou de renseignement non-communistes, sont déportés dans de petits convois sécurisés.
Ils prennent, depuis août 1943, régulièrement la direction de Natzweiler avant d’être
redirigés vers d’autres camps via Sarrebruck. Les femmes classées dans cette procédure
sont pour leur part internées au camp de Ravensbrück. Sur le territoire occupé par
le MBF, quelque 1 500 déportés font
les frais de cette procédure entre juillet 1943 et avril 1944 [16] 16. T. Fontaine, Dé (…) . Ainsi, dans le Calvados, l’état-major du Front national est capturé à l’automne
1943 : le responsable régional, Michel de Bouard  , mais aussi André Louvel
, mais aussi André Louvel  sont déportés en mars 1944 dans un petit convoi de 52 hommes destinés à la prison
de Saarbrücken.
sont déportés en mars 1944 dans un petit convoi de 52 hommes destinés à la prison
de Saarbrücken.
Reste que si la plupart des résistants arrêtés sont désormais directement versés dans le système concentrationnaire nazi sans perspective de jugement, que ce soit dans des convois massifs ou de plus petits convois, la justice militaire demeure un instrument structurant du schéma répressif allemand jusqu’à la fin de l’été 1944. La dernière année d’occupation voit la terreur judiciaire atteindre des sommets. Au cours des premiers mois de l’année 1944, la répression judiciaire pratiquée par les tribunaux militaires franchit même un nouveau palier, que le débarquement de Normandie ne fait que radicaliser en conférant aux jugements rendus et immédiatement exécutés un caractère expéditif de plus en plus marqué. L’activité des tribunaux allemands n’a jamais été aussi forte. Plus meurtriers que jamais, ils prononcent au cours des quatre premiers mois de 1944 environ 900 peines capitales. Plus de 350 sont encore prononcées et 325 exécutées en juin-juillet 1944. Le taux d’exécution des peines capitales dépasse désormais 90%.
En Normandie, les jugements s’avèrent moins sévères. Entre janvier et mai 1944, 75
jugements de détenus, tous résistants, arrêtés en Normandie sont prononcés, dont 21
condamnations à mort, quatre résistants du réseau Arc-en-Ciel de la région de Vire
arrêtés en mars 1944 sont condamnés à mort. Le 17 mai 1944, sont fusillés Henri Bossu  , Edouard Fizel
, Edouard Fizel  , André Guilbert
, André Guilbert  et Gabriel Schuh
et Gabriel Schuh  .
.
Suivant une tendance constatée depuis l’automne 1942, les FTP, jugés « doublement coupables », pour leurs actions armées et leur engagement
idéologique, demeurent les principales cibles des tribunaux allemands. Ils sont ainsi
bien moins présents que les résistants non-communistes dans les convois de déportés
de répression. Ils représentent en revanche près de 50% des fusillés et leur taux
d’exécution est sensiblement supérieur à celui des autres condamnés à mort. En Normandie,
dix des 21 condamnés à mort sont des FTP, comme Clovis Vigny  domicilié à Ezy dans l’Eure. C’est aussi le cas de Marcel Lemoulan
domicilié à Ezy dans l’Eure. C’est aussi le cas de Marcel Lemoulan  , Jacques Louvel
, Jacques Louvel  , Bernard Montigny
, Bernard Montigny  , André Suriray
, André Suriray  , Henri
, Henri  et Robert Gagnaire
et Robert Gagnaire  , les six jeunes résistants du maquis de Vrigny arrêtés par la gendarmerie et les
Renseignements généraux après l’échec d’un attentat contre un collaborateur. Ils sont
fusillés le 27 avril 1944 à la carrière des Aulnaies à Saint-Germain-du-Corbéis (Orne),
après avoir été condamnés à mort quelques jours plus tôt par le tribunal de la FK
591.
, les six jeunes résistants du maquis de Vrigny arrêtés par la gendarmerie et les
Renseignements généraux après l’échec d’un attentat contre un collaborateur. Ils sont
fusillés le 27 avril 1944 à la carrière des Aulnaies à Saint-Germain-du-Corbéis (Orne),
après avoir été condamnés à mort quelques jours plus tôt par le tribunal de la FK
591.
Un certain rééquilibrage s’opère cependant à compter de l’automne 1943. Celui-ci se
dessine au moment où de plus en plus de résistants liés à des organisations non-communistes,
devenus plus vulnérables car pratiquant désormais l’action directe et armée, sont
renvoyés devant les tribunaux de l’occupant. Dans l’Eure et la Seine-Inférieure par
exemple, les réseaux Cohors et Brutus sont terriblement fragilisés. L’arrestation
d’Albert Forcinal  , pris dans une rafle à Paris, sonne le début de nombreuses interpellations. Césaire Levillain
, pris dans une rafle à Paris, sonne le début de nombreuses interpellations. Césaire Levillain  est ainsi condamné à mort pour espionnage par le tribunal de la FK
517 de Rouen, le 25 février 1944. Il est fusillé au Madrillet (Grand-Quevilly) le
4 mars 1944. D’autres partent en déportation. Lucien Perret
est ainsi condamné à mort pour espionnage par le tribunal de la FK
517 de Rouen, le 25 février 1944. Il est fusillé au Madrillet (Grand-Quevilly) le
4 mars 1944. D’autres partent en déportation. Lucien Perret  , son frère Marcel
, son frère Marcel  et son fils Alfred
et son fils Alfred  montent ainsi dans l’un des wagons du convoi parti pour Buchenwald le 17 janvier
1944.
montent ainsi dans l’un des wagons du convoi parti pour Buchenwald le 17 janvier
1944.
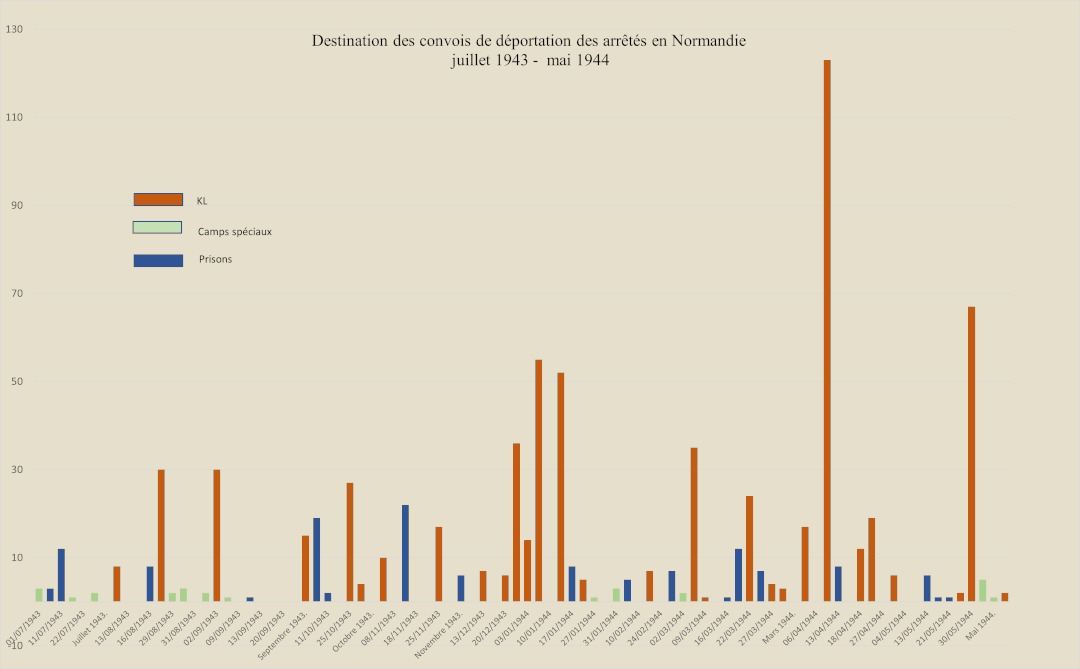
La généralisation des convois massifs n’a pas non plus entraîné la suspension des déportations judiciaires par petits convois. Les déportations carcérales se font même plus nombreuses depuis l’abaissement du seuil de départ vers les prisons du Reich. En Normandie, 232 interpellations conduisent à un départ de ce type.
Le profil de ces déportés est en revanche assez similaire à celui observé depuis la
fin de l’automne 1942, les condamnés de droit communs étant presque aussi nombreux
à subir ce type de transferts que les auteurs de manifestation de refus de l’ordre
allemand. Dans la Manche, la plupart des condamnations (neuf sur douze) concernent
même des droits communs. Condamné à deux ans de prison pour faux en écriture et déporté
vers la prison de Karlsruhe, Charles Agnès  appartient toutefois au réseau Centurie. L’occupant continue par ailleurs à recourir
au classement « NN Wehrmacht » pour déporter des auteurs
d’actes graves dirigés contre la puissance occupante qui n’ont pas été classés « NN Gestapo », mais dont la condamnation à mort ne parait pas pour autant
assurée ou susceptible d’être prononcée et exécutée assez rapidement en France occupée.
Environ 1 400 civils sont visés par cette procédure la dernière année d’Occupation
et dirigés, dans l’attente d’un éventuel procès, vers le camp d’Hinzert puis vers
celui de Natzweiler à partir de l’automne 1943. En Normandie, on dénombre dix déportations
vers le camp d’Hinzert à l’automne 1943.
appartient toutefois au réseau Centurie. L’occupant continue par ailleurs à recourir
au classement « NN Wehrmacht » pour déporter des auteurs
d’actes graves dirigés contre la puissance occupante qui n’ont pas été classés « NN Gestapo », mais dont la condamnation à mort ne parait pas pour autant
assurée ou susceptible d’être prononcée et exécutée assez rapidement en France occupée.
Environ 1 400 civils sont visés par cette procédure la dernière année d’Occupation
et dirigés, dans l’attente d’un éventuel procès, vers le camp d’Hinzert puis vers
celui de Natzweiler à partir de l’automne 1943. En Normandie, on dénombre dix déportations
vers le camp d’Hinzert à l’automne 1943.
3.3. « Nettoyage des départements de toute présence juive »
↑À l’automne 1943, les arrestations contre les populations juives se poursuivent en
Normandie comme ailleurs. Le 22 octobre, la Sipo-SD
organise une grande rafle, notamment dans la Manche, le Calvados et l’Eure. À cette
époque pourtant, la population juive ne représente guère plus de 300 personnes déclarées
qui, faute de moyen ou en raison de leur âge, n’ont pu envisager de quitter la région.
Prétextant des impératifs militaires, le préfet régional, André Parmentier, décrète
de son propre chef, le 10 novembre 1943, le repli vers l’intérieur des terres des
Juifs où, prétend-il, ils seraient confiés aux bons soins de l’UGIF. Si quelques familles prévenues à temps par des policiers
ou des gendarmes réussissent à prendre la fuite, on compte encore une centaine de
personnes envoyée dans les camps d’extermination entre octobre 1943 et mai 1944. 75%
d’entre eux sont des Juifs de nationalité française (contre environ 45% à l’échelle
nationale). Parmi les nombreuses familles à avoir été décimées : la famille Simsohn  de Bernay et la famille Calderon
de Bernay et la famille Calderon  de Saint-Sulpice-sur-Risle. Mentionnons également deux jeunes garçons de Mont-Saint-Aignan,
Henri
de Saint-Sulpice-sur-Risle. Mentionnons également deux jeunes garçons de Mont-Saint-Aignan,
Henri  et Bernard Rybstein
et Bernard Rybstein  , ou encore Michèle Albagli,
, ou encore Michèle Albagli,  5 ans, originaire de Mortain…
5 ans, originaire de Mortain…
Les Juifs originaires de Normandie qui s’étaient réfugiés en zone Sud avant son invasion
par l’armée allemande en novembre 1942 n’échappent pas non plus aux persécutions.
Le maire du Havre Léon Meyer  , son épouse
, son épouse  et sa fille
et sa fille  , cachés en Isère, sont arrêtés. Ils figurent parmi les rares rescapés des camps.
Rachel Saidemann
, cachés en Isère, sont arrêtés. Ils figurent parmi les rares rescapés des camps.
Rachel Saidemann  , de Caen, est arrêtée en Haute-Garonne en janvier 1944. La famille Piterman,
, de Caen, est arrêtée en Haute-Garonne en janvier 1944. La famille Piterman,  du Havre, est quant à elle interpellée à Montauban (Tarn-et-Garonne).
du Havre, est quant à elle interpellée à Montauban (Tarn-et-Garonne).
Arrêtées les 25 et 28 mai 1944, Léa Berger  , Etti Grimberg
, Etti Grimberg  et Marie Swica
et Marie Swica  , d’origine roumaine, domiciliées à Marcilly-la-Campagne et à Beaucé dans l’Eure,
figurent probablement parmi les dernières victimes de la persécution nazie en Normandie.
, d’origine roumaine, domiciliées à Marcilly-la-Campagne et à Beaucé dans l’Eure,
figurent probablement parmi les dernières victimes de la persécution nazie en Normandie.
4. Après le débarquement, le temps des massacres
↑
4.1. Les exécutions sommaires et les massacres se multiplient
↑Le 6 juin 1944, les troupes alliées débarquent en Normandie. À l’arrière du front, les confrontations directes entre résistants et occupants s’intensifient. Certes, le nombre de résistants tués dans le cadre de ces affrontements dépasse désormais celui des civils non combattants abattus. Les combats ne s’en accompagnent pas moins d’un déchaînement de violence à l’encontre des populations civiles qui ne se limite pas au seul massacre d’Oradour-sur-Glane.
Le MBF qui ne dispose pas d’attributions en matière d’opérations militaires, mais qui a conservé toute autorité sur les questions touchant à la sécurité militaire de la puissance occupante en dépit du transfert de ses pouvoirs de police à la Sipo-SD, y occupe un rôle de premier plan. C’est qu’aux yeux des autorités militaires allemandes, les actions de la Résistance armée ne sont plus un simple problème policier. Elles sont aussi et surtout devenues un problème militaire exigeant une coopération plus étroite que jamais entre les différentes instances allemandes, militaires et policières. Aux allures de campagnes militaires, ces opérations s’apparentent de plus en plus souvent à des expéditions punitives ponctuées de massacres de civils, de pillages, de destructions et de déportations. La « lutte contre les bandes » rappelle désormais à certains égards la « guerre contre les partisans » menée depuis 1941 en Europe de l’Est.
Les départements de l’Orne, de l’Eure et de Seine-Inférieure, où les maquis s’avèrent les plus importants, subissent de plein fouet ces redoutables chasses à l’homme, lesquelles se soldent par de nombreuses exécutions sommaires. Les résistants sont loin d’être les seules victimes de ces exactions. En Normandie, 788 victimes tuées sommairement durant l’année 1944 ont été recensées à ce jour, dont la moitié seulement étaient des résistants « tués en action », c’est-à-dire lors d’une opération de renseignement, de combat ou de récupération d’armes. La carte et le graphique identifient clairement la relation entre l’intensité des combats et le nombre de victimes dans chaque département.
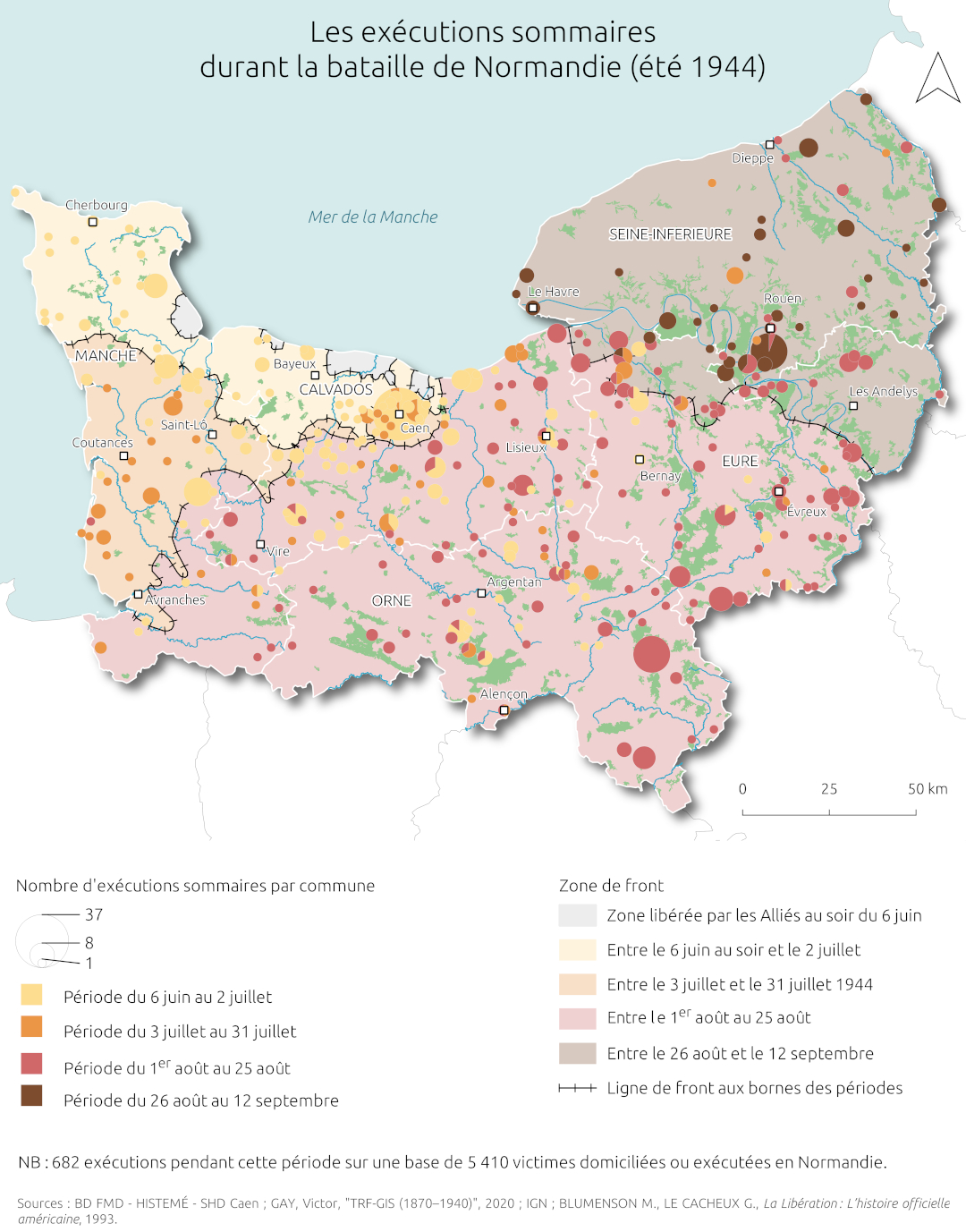
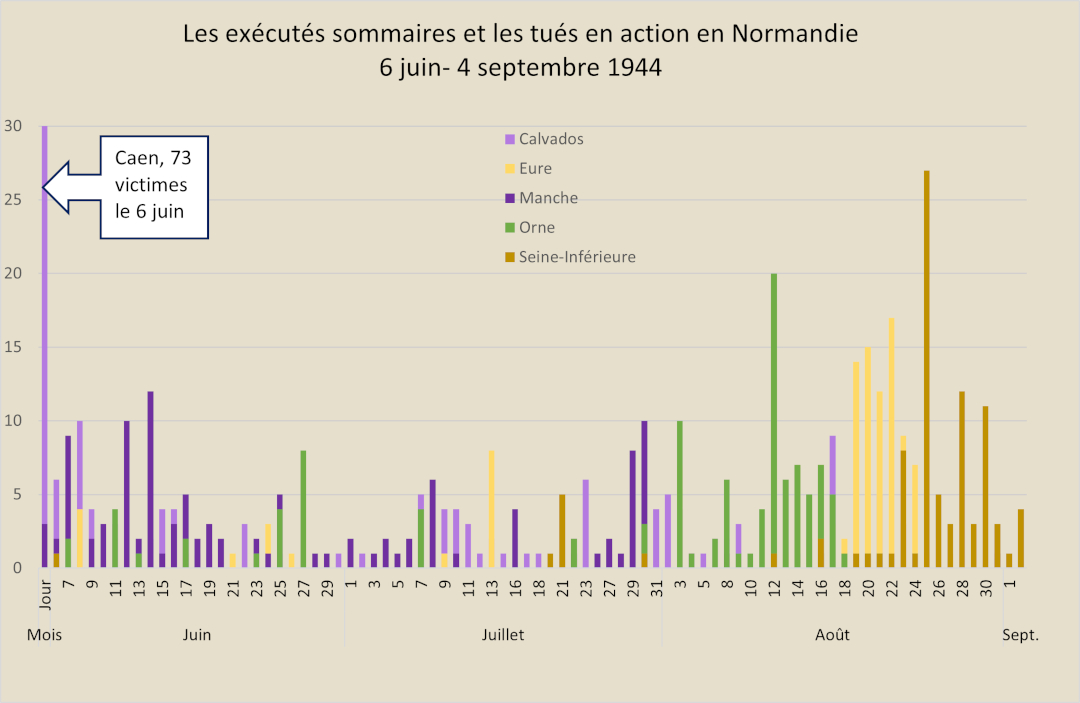
Dans la Manche, le 15 juin, une soixantaine de soldats allemands prennent d’assaut
la ferme où se cachent dix maquisards du maquis de Beaucoudray. Ils sont arrêtés et
exécutés sur place. Plusieurs jeunes réfractaires au STO
figurent parmi eux, dont un jeune corse, Jacques Albertini  , mais aussi Étienne Bobo
, mais aussi Étienne Bobo  et Jean Le Couturier
et Jean Le Couturier  . Fin juillet, une quinzaine d’hommes sont capturés à Fouguerolles-du-Plessis. Interrogés
au château de Saint-Jean à Saint-Jean-du-Corail, ils sont passés par les armes quelques
jours plus tard. Ainsi de Julien Derenne
. Fin juillet, une quinzaine d’hommes sont capturés à Fouguerolles-du-Plessis. Interrogés
au château de Saint-Jean à Saint-Jean-du-Corail, ils sont passés par les armes quelques
jours plus tard. Ainsi de Julien Derenne  , de Victor Fréard
, de Victor Fréard  et de Jacques Cercleux
et de Jacques Cercleux  .
.
Dans l’Orne, les combats entre les Allemands et les FFI
du maquis de Lignières-la-Doucelle provoquent la mort de 12 FFI, tués au combat ou achevés ensuite. Le 28 juin, le maquis de Francheville-Boucé
est décimé. Dix résistants sont passés par les armes, parmi lesquels Marcel Klein  , Joseph Goubin
, Joseph Goubin  et Georges Toutain
et Georges Toutain  .
.
Dans l’Eure, dès le 6 juin, les jeunes maquisards Bernard Gosselin  et André Reinert
et André Reinert  , originaires de la région de Pont-Audemer et de Saint-Georges-du-Vièvre, tombent
dans des combats inégaux. Aux actions menées sous commandement allemand, s’ajoutent
celles initiées par la police française, parfois aidée de policiers allemands. Elle
traque sans répit le chef du maquis Surcouf, Robert Leblanc, et ses hommes. Charles Foutel
, originaires de la région de Pont-Audemer et de Saint-Georges-du-Vièvre, tombent
dans des combats inégaux. Aux actions menées sous commandement allemand, s’ajoutent
celles initiées par la police française, parfois aidée de policiers allemands. Elle
traque sans répit le chef du maquis Surcouf, Robert Leblanc, et ses hommes. Charles Foutel  et Jacques Rideau
et Jacques Rideau  sont dénoncés par un résistant infiltré et exécutés à Bouquelon, le 4 août. Marceau Flandre
sont dénoncés par un résistant infiltré et exécutés à Bouquelon, le 4 août. Marceau Flandre  , Louis Gillain
, Louis Gillain  et huit autres camarades subissent le même sort à Angerville, le 13 août.
et huit autres camarades subissent le même sort à Angerville, le 13 août.

Aux facteurs de radicalisation de la violence procédant d’une logique propre aux unités engagées dans la « lutte contre les bandes », s’ajoutent les consignes de plus en plus brutales reçues du Haut Commandement militaire et relayées par le MBF. Celles-ci incitent, à partir de février 1944, les troupes allemandes à s’en prendre pour la première fois directement aux populations civiles au titre de mesures d’intimidation et de dissuasion. Reste que les atrocités commises en France par l’occupant ne témoignent pas de l’abolition, au même degré qu’à l’Est, de la frontière entre combattants et non combattants, c’est-à-dire entre « civils innocents » et résistants, entre hommes et femmes, entre adultes et enfants.
Le Jour du Débarquement sur les côtes normandes, à la prison de Caen, faute de pouvoir
être déportés – la gare de Caen étant partiellement détruite par les bombardements
– 73 détenus sont passés par les armes. Certains n’ont pas vingt ans, comme Jean Hébert  . Les résistants sont nombreux parmi eux : Robert Douin et Georges Thomine du réseau
Alliance ; Michel et Achille Bouttois du Front national, etc. Harald Heyns, chef de
la Sipo-SD, est responsable du
massacre. Les détenus de Caen ne sont pas les seuls à être massacrés de la sorte en
France. Au total, quelque 600 détenus politiques ont été exécutés sommairement après
avoir été extraits des prisons, à Caen mais aussi à de Rodez, Nice ou encore de Brest.
. Les résistants sont nombreux parmi eux : Robert Douin et Georges Thomine du réseau
Alliance ; Michel et Achille Bouttois du Front national, etc. Harald Heyns, chef de
la Sipo-SD, est responsable du
massacre. Les détenus de Caen ne sont pas les seuls à être massacrés de la sorte en
France. Au total, quelque 600 détenus politiques ont été exécutés sommairement après
avoir été extraits des prisons, à Caen mais aussi à de Rodez, Nice ou encore de Brest.
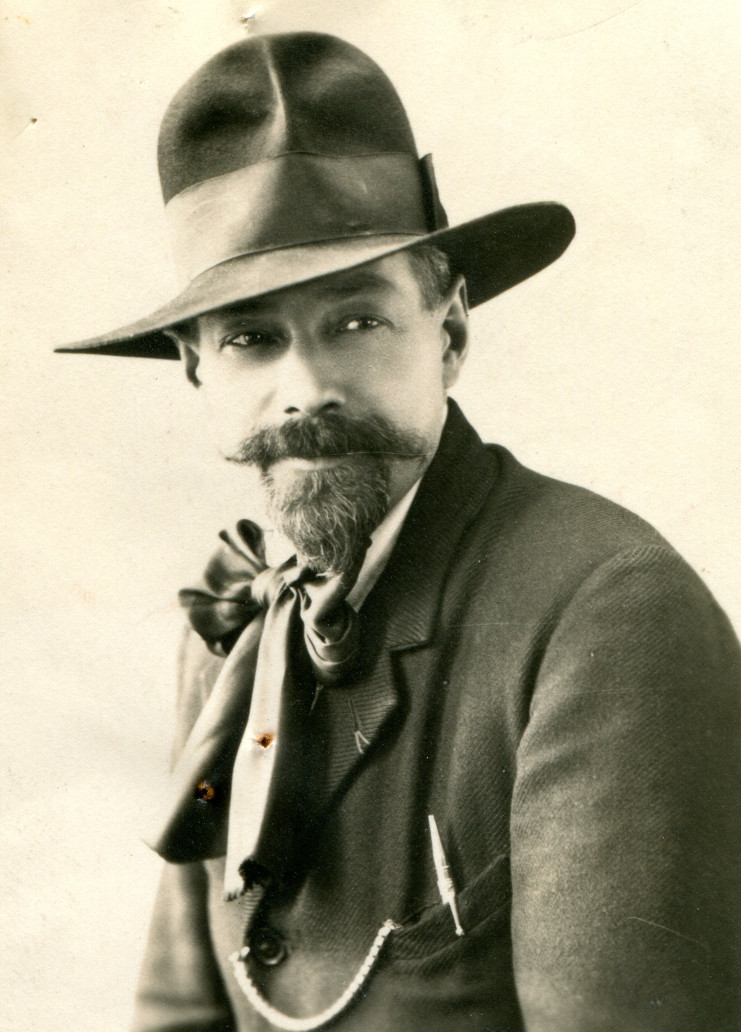
Repliés à Argences après le Débarquement, des membres du SD
de Caen cachent leurs basses œuvres : un charnier est découvert après la guerre près
d’Argences. Des 28 cadavres exhumés, seuls 18 ont été identifiés, dont Yves Diverres  .
.
En Normandie, le 13 août, alors que le village de Tourouvre est sur le point d’être
libéré, les troupes SS stationnées sur place se déchaînent
suite à un mitraillage de l’aviation américaine. Des soldats allemands sont tués.
Accusées de complicité, dix-huit personnes sont abattues, d’autres sont prises en
otages et le village est incendié. Parmi les nombreuses victimes, des femmes comme
Louise Charron  , mais aussi un jeune réfugié des équipes d’urgence de Caen, Jean Molton
, mais aussi un jeune réfugié des équipes d’urgence de Caen, Jean Molton  , ou encore un vieil homme de 70 ans, René Armand.
, ou encore un vieil homme de 70 ans, René Armand.  À la fin du mois d’août, quelques jours avant la libération de Saint-Étienne du Rouvray,
des résistants et des civils se mêlent dans la forêt toute proche. Des soldats sur
les dents mitraillent des habitants, hommes, femmes et jeunes adolescents confondus.
Louise Cellier
À la fin du mois d’août, quelques jours avant la libération de Saint-Étienne du Rouvray,
des résistants et des civils se mêlent dans la forêt toute proche. Des soldats sur
les dents mitraillent des habitants, hommes, femmes et jeunes adolescents confondus.
Louise Cellier  et Louise Lebret
et Louise Lebret  sont tuées ce jour-là. Au même moment, quelques centaines de mètres plus loin, des
résistants sont passés par les armes près de la maison du garde forestier. Lucien Carpentier
sont tuées ce jour-là. Au même moment, quelques centaines de mètres plus loin, des
résistants sont passés par les armes près de la maison du garde forestier. Lucien Carpentier  figure parmi eux. Bernard Flament
figure parmi eux. Bernard Flament  , blessé d’une balle, est achevé.
, blessé d’une balle, est achevé.
Les victimes sont aussi nombreuses dans le contexte particulier que représente la
traversée de la Seine. Épuisés, les soldats allemands cherchent à franchir le fleuve
pour échapper aux alliées qui les talonnent. Tous les moyens de locomotion sont réquisitionnés,
parfois sous la menace d’une arme. Des hommes sont emmenés pour les faire fonctionner.
Dans ce contexte de tension extrême, traverser un champ peut suffire à devenir la
cible de tirs meurtriers. Emmenés par une formation cycliste, André Cornu  – un jeune charretier –, René Fanonnel
– un jeune charretier –, René Fanonnel  – réfugié – et Claude Marécal
– réfugié – et Claude Marécal  – commis de ferme – sont massacrés à coup de baïonnette et de crosse de fusil le
3 septembre 1944, non loin d’Octeville-sur-Mer (Seine-Inférieure), sans qu’aucun témoin
ni archive ne puissent expliquer ce drame.
– commis de ferme – sont massacrés à coup de baïonnette et de crosse de fusil le
3 septembre 1944, non loin d’Octeville-sur-Mer (Seine-Inférieure), sans qu’aucun témoin
ni archive ne puissent expliquer ce drame.
4.2. Les déportations continuent
↑4.2.1. Les « Proeminenten »
↑Des convois de personnalités civiles et militaires sont formés dès l’été 1943. Ils
résultent de l’inquiétude du Quartier Général de Hitler de voir passer à la dissidence
un certain nombre d’hommes politiques et d’officiers supérieurs français en cas de
débarquement allié. En Normandie, une trentaine de personnes sont arrêtées à ce titre
après le Débarquement. Elles sont toutes déportées les 15 et 28 juillet 1944 vers
le camp de Neuengamme. Trois arrestations « préventives » ont lieu dans l’Orne, en
mars 1944. Elles visent Jean Fauquet  , Maurice Gardye
, Maurice Gardye  et René Wains-Desfontaines
et René Wains-Desfontaines  . Après le Débarquement, seuls les départements de la Seine-Inférieure et de l’Eure
restent sous autorité allemande. L’occupant procède à 25 arrestations de ce type en
Seine-Inférieure. Alphonse Moulin
. Après le Débarquement, seuls les départements de la Seine-Inférieure et de l’Eure
restent sous autorité allemande. L’occupant procède à 25 arrestations de ce type en
Seine-Inférieure. Alphonse Moulin  , inspecteur de police aux Renseignements généraux, et Maurice Poissant
, inspecteur de police aux Renseignements généraux, et Maurice Poissant  , maire de Rouen par intérim, en font les frais.
, maire de Rouen par intérim, en font les frais.
4.2.2. Déporter coûte que coûte
↑Le Débarquement n’avait pas modifié le dispositif répressif allemand en place depuis
la seconde moitié de l’année 1943. Dans l’Orne, seize maquisards ont ainsi ete jugés
et condamnés à mort par le tribunal militaire de la FK
916, les 22 et 30 juin 1944. De jeunes réfractaires au STO se trouvaient parmi eux : Raymond Balonnier  , Gilbert François
, Gilbert François  et Jean Tirard
et Jean Tirard  . Membre du maquis de Coudehard dans l’Orne, Léopold Duval
. Membre du maquis de Coudehard dans l’Orne, Léopold Duval  fut lui aussi jugé avant d’être déporté, le 2 août 1944.
fut lui aussi jugé avant d’être déporté, le 2 août 1944.
La victoire des Alliés dans la bataille de Normandie, à la suite de la percée d’Avranches
opérée dans la Manche par les troupes américaines, conduit en revanche à la simplification
du schéma répressif allemand. Le repli des troupes et des services allemands met en
effet assez rapidement fin aux procédures de la justice militaire allemande, même
si quelques procès ont encore lieu jusqu’à la fin du mois d’août. Le dernier procès
de résistant se déroule en Normandie le 10 août 1944. Il implique Sabin Sappey de Mirebel  , déféré devant la FK du Havre pour avoir saboté la
base sous-marine, avant d’être déporté le 17 août 1944 vers le KL Buchenwald.
, déféré devant la FK du Havre pour avoir saboté la
base sous-marine, avant d’être déporté le 17 août 1944 vers le KL Buchenwald.
La retraite de l’armée d’occupation ne signe pas en revanche l’arrêt des déportations
massives. Entre le mois d’août et le mois de novembre 1944, au moins 10 600 personnes
sont ainsi dirigées vers le Reich dans des convois massifs. Outre les derniers convois
de la région parisienne, d’autres se forment depuis les zones de repli successives
des Allemands, en particulier à l’Est du territoire. Signe de l’emballement tragique
de ce moment répressif, hommes et femmes, victimes de la répression et victimes des
persécutions raciales, se côtoient pour la première fois régulièrement dans ces ultimes
convois. Le 29 août, Léon Tahoré  arrêté dans l’Eure et Henri Coisy
arrêté dans l’Eure et Henri Coisy  du Havre, arrêté dans le Morbihan, partent de la gare de Belfort. Les Adelson, Jack
du Havre, arrêté dans le Morbihan, partent de la gare de Belfort. Les Adelson, Jack  et Jules
et Jules  , juifs rouennais, réfugiés à Pau, sont déportés le 30 juillet 1944 vers le KL Buchenwald dans un de ces convois mixtes (K81). Arrêtée
le même jour, leur nièce Micheline Kremer
, juifs rouennais, réfugiés à Pau, sont déportés le 30 juillet 1944 vers le KL Buchenwald dans un de ces convois mixtes (K81). Arrêtée
le même jour, leur nièce Micheline Kremer  est envoyée à Ravensbrück.
est envoyée à Ravensbrück.
Alors que la Normandie est le théâtre d’opérations militaires d’une ampleur exceptionnelle, les autorités allemandes déportent encore 646 personnes durant les mois de juin, juillet et août 1944.